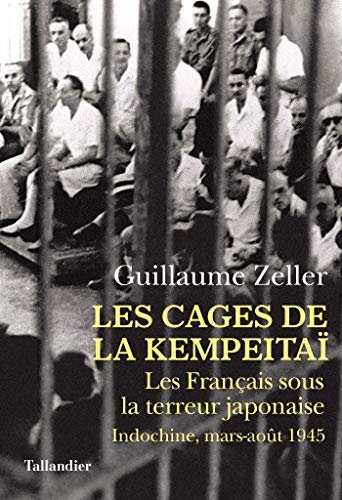Pourquoi avez-vous choisi de revenir sur cette partie de l’histoire française ?
Durant toute mon enfance et mon adolescence, j’ai entendu parler des horreurs perpétrées par les Japonais en Indochine après l’agression du 9 mars 1945. Il se trouve en effet que mes grands-parents étaient sur place à l’époque, ainsi que ma mère et son frère, alors jeunes enfants. Tous ont été enfermés dans un véritable ghetto mis en en place par les occupants à Phnom Penh au Cambodge. Ils ont heureusement échappé au pire, ce qui ne fut pas le cas de milliers d’autres compatriotes, massacrés, déportés ou torturés. Mais si leur histoire m’était connue dans les grandes lignes. Je me suis aperçu que personne ne connaissait cet épisode hors du cercle restreint des survivants et de leurs familles. Pour des raisons géographiques, chronologiques et idéologiques, ces hommes et ces femmes sont tombés dans une véritable « trappe mémorielle ». C’est une véritable double peine pour ces victimes d’exactions innommables, puis reléguées hors de la mémoire collective. Plus de soixante-dix ans après les faits, il me semblait important de raconter leur histoire.
« A Langson, théâtre du massacre de centaines de prisonniers français, exécutés à la mitrailleuse, à la pioche ou au sabre »
Qui étaient ces Français d’Indochine ?
Il s’agissait d’une communauté de 40.000 personnes, réparties sur un territoire de 750.000 km², lui-même peuplé de 24 millions d’Indochinois, c’est-à-dire d’Annamites – comme on appelait alors les Vietnamiens – de Laotiens et de Cambodgiens. Sans compter une puissante communauté chinoise. Ces Français étaient pour beaucoup militaires – près de 18.000 – mais aussi fonctionnaires, commerçants, colons. Ils étaient essentiellement concentrés à Hanoï, Haïphong et Saïgon-Cholon. De grosses fortunes côtoyaient des profils bien plus modestes. La réalité de la société coloniale en Indochine est à chercher quelque part entre les clichés exotiques qui font rêver – Angkor, la baie d’Along, les danseuses cambodgiennes, la jungle mystérieuse – et les descriptions sordides des «petits blancs » rongés par la corruption, exploitant sans vergogne les ressources naturelles et les « nha que », comme on appelait alors les paysans annamites. Le quotidien était bien plus prosaïque, même si la guerre a bien sûr redistribué les cartes subitement.
Quelles ont été vos sources ? L’écriture du livre vous a-t-elle demandé un travail important ?
La difficulté majeure de ce travail fut en effet de constituer un corpus solide. De nombreuses archives ont été brûlées par les militaires français lors du coup de force, ou par les Japonais après leur défaite. J’ai en revanche retrouvé au Service Historique de la Défense, à Vincennes, de nombreux comptes-rendus rédigés lors du retour des Français à l’automne 1945. De ces documents, je n’ai conservé que les informations que j’ai pu recouper. Parallèlement, j’ai pu retrouver de nombreux témoignages ou travaux disséminés sur tous les supports écrits imaginables : des livres, bien sûr, mais aussi des récits édités à compte d’auteur, des articles dans des bulletins associatifs d’ « anciens d’Indochine », des monographies publiées dans des revues scientifiques, des carnets de croquis… Au total, il y a vraiment de la matière pour travailler : le tout est de l’identifier, de la trier et de la vérifier. Ce qui manque cruellement, en revanche, ce sont des photos ou des films : tous les appareils avaient été confisqués par les Japonais, si bien que l’on ne peut aujourd’hui se fonder que sur des témoignages écrits ou oraux pour décrire les sinistres cages ou les camps de la mort où furent emprisonnés des centaines de Français.
« Il faut rappeler que plusieurs des centres de torture et des camps de travail japonais ont été reconnus comme lieux de déportation »
Le contexte dans lequel nous plonge le livre est plutôt méconnu. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Durant la Seconde guerre mondiale, l’Indochine était dirigée par l’amiral Decoux, nommé par Vichy dès 1940, dont la principale tâche fut de maintenir la souveraineté française face aux prétentions japonaises, mais aussi thaïlandaises, indépendantistes ou communistes. Lorsque les Japonais les attaquent le 9 mars 1945, ces hommes et ces femmes vivent dans une autarcie presque complète, à 10.000 kilomètres de la France qui fête alors sa Libération tandis que les Allemands livrent leurs derniers combats en-deçà du Rhin. Les armées japonaises enchaînent alors les revers. C’est à la suite de la prise de Manille le 3 mars que l’attaque est déclenchée. L’objectif est de sécuriser une voie de repli pour les troupes qui affrontent les Britanniques en Birmanie, et d’éradiquer les mouvements clandestins français qui, sur le sol Indochinois, s’efforcent de transmettre des informations aux Alliés. Sentant la fin inexorable, on peut aussi supposer que les Japonais ont voulu que leur défaite soit au moins l’occasion d’éradiquer la présence occidentale en Asie du Sud-Est.
Que reste-t-il de ces prisons dans cette région ? Et dans les souvenirs de ses habitants… et des Français ?
A vrai dire, il n’en reste rien. Les centres de torture de la Kempeitaï, surnommée la « Gestapo japonaise », à Hanoï, Haïphong, Nam Dinh, Vinh, Saïgon ou Phom Penh avaient été installés dans des bâtiments publics ou commerciaux qui furent rapidement réaffectés après la guerre. Quant aux camps de concentration de Hoa Binh ou de Paksong, constitués de bambous et de branchages, ils ont vite disparu, digérés par le climat luxuriant. A Langson, théâtre du massacre de centaines de prisonniers français, exécutés à la mitrailleuse, à la pioche ou au sabre, des recherches ont en revanche permis de relever de nombreuses dépouilles. Un ossuaire impressionnant a été érigé en novembre 1947, mais il a été rasé depuis. Cet épisode a été estompé dans la mémoire des Vietnamiens qui ont connu ensuite près de trois décennies de guerre cruelle. Concernant les Français, cet épisode n’était connu – ou presque – que de ceux qui avaient été touchés dans leur chair ou dans leur généalogie. Mais les choses pourraient changer : on assiste au Japon, au Vietnam ou en France à une floraison de travaux universitaires innovants qui se réapproprient le sujet. Car au-delà de la tragédie humaine, le coup de force japonais en Indochine aura des répercussions géopolitiques majeures. Il s’agit d’un des actes fondateurs du grand mouvement de décolonisation du « second XXe siècle ».
« Chaque année, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, une grande bannière rayée de bleu et de blanc, est érigée sur l’île de la Cité à Paris : la mention Camps japonais »
Ne craignez-vous pas que votre livre soit « accusé » de révisionnisme ?
Le révisionnisme, comme sa déclinaison la plus extrême, le négationnisme, poursuit deux objectifs : relativiser voire nier les souffrances infligées à une communauté humaine, et proposer une lecture idéologique de l’histoire. Je ne peux donc imaginer que mon travail puisse soulever une telle question puisqu’il s’agit au contraire de faire connaître un destin et une tragédie oubliés, et de se contenter de restituer des faits bruts. Ce qui peut s’avérer troublant, c’est l’utilisation d’un vocabulaire intrinsèquement associé à l’horreur de la Shoah : ghettos, camps de concentration… Il faut donc manier ces termes avec prudence et délicatesse, en veillant à leur mise en perspective. Néanmoins, il faut rappeler que plusieurs des centres de torture et des camps de travail japonais ont été reconnus comme « lieux de déportation » par un arrêté du ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre en date du 22 janvier 1951. Chaque année, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, une grande bannière rayée de bleu et de blanc, est érigée sur l’île de la Cité à Paris : la mention « Camps japonais » figure tout en bas après Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, Treblinka et tous les camps nazis. Alors non, parler de révisionnisme serait franchement insultant, à moins de vouloir introduire une concurrence victimaire particulièrement malsaine.
Vous travaillez déjà sur d’autres projets littéraires ? Si oui, pourriez-vous nous en dire plus ?
Je commence en effet à constituer une documentation en vue d’un nouveau livre. Mais en effet, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, sinon qu’il s’agit encore d’un récit oublié !
« Dans les cages de la Kempetaï »
de Guillaume Zeller
Editions Tallandier. 320 pages – 20,90 Euros