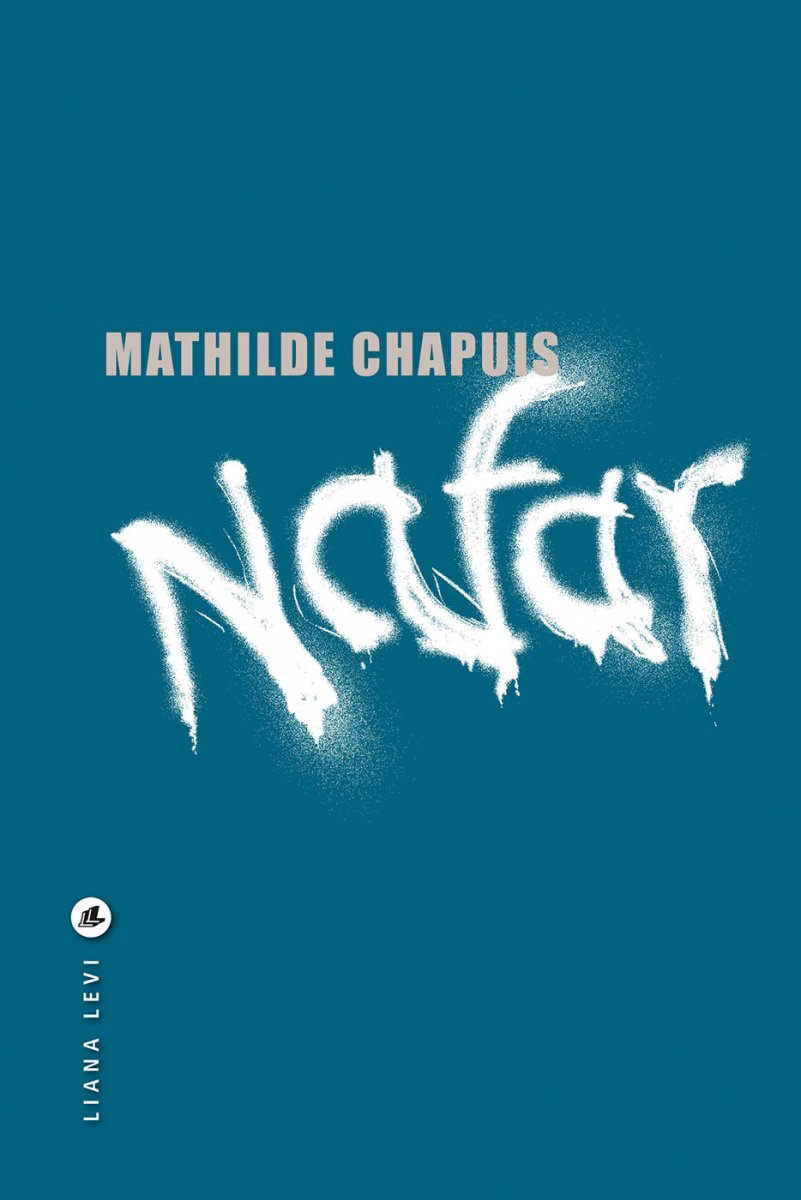Le choix de situer le point de départ de votre livre sur les rives du fleuve-frontière entre la Turquie, la Grèce et la Bulgarie, sert à rappeler que la crise des migrants ne se déroule pas que en Méditerranée ?
Disons plutôt que, pour l’intrigue de mon récit, le fleuve m’intéressait davantage que la mer. Le fleuve circule, chemine, relie des villes à d’autres, et en même temps délimite et sépare. C’est un élément symbolique fort. Et puis je voulais plonger le lecteur dans la solitude d’un homme qui tente le passage et se confronte seul, à l’insu de tous, à des conditions de traversée hostiles. Ce qui n’aurait pas été possible en racontant une traversée en mer où les passages se font collectivement. Mais mon intérêt pour le fleuve Meriç-Evros ne signifie pas que je hiérarchise l’importance des différents lieux de trafics migratoires. Les médias mettent l’accent sur ce qu’il se passe en Méditerranée et c’est parfaitement compréhensible : elle est la voie maritime la plus meurtrière au monde pour ceux qui doivent voyager clandestinement. D’ailleurs, ces derniers le savent. S’ils en ont la possibilité, ils cherchent des trajets plus sûrs. La traversée du Meriç, dont la dangerosité est moins connue, peut leur apparaître comme un moyen d’arriver en Europe sain et sauf.
On ne connait pas l’identité du personnage principal de votre roman, mais pourriez-vous esquisser le profil de ce nafar?
Il est originaire de Homs, l’une des villes syriennes où la révolte contre Bachar al Assad a été forte, organisée, et matée impitoyablement. Il est de ceux, un peu trop optimistes, qui ont cru au départ rapide du dictateur et à l’avènement d’un régime démocratique. Il sait ce que c’est que d’être en danger, menacé à cause de ses idées politiques. Il a été confronté à la mort. Puis il a tout perdu. Il ne lui reste rien. Il n’a plus de chez lui, il est déboussolé. D’abord patron de café à Homs, il est devenu employé corvéable dans un bar d’Istanbul. Pour échapper à ce sort, il cherche à tout prix à rejoindre la Suède. Et il est habité par un souffle, une volonté presque féroce d’y parvenir.
« Le nafar est celui qui est piégé dans un espace intermédiaire entre son lieu de départ et celui où il souhaite parvenir »
En évoquant la vie dans Homs on pense à une phase révolue de la vie de ce nafar. A votre avis, pourquoi en est on arrivé là ?
Par « en être arrivé là », vous entendez sûrement la situation d’un pays détruit après huit ans de guerre, où une grande partie des habitants se sont déplacés ou exilés, où le dictateur que l’on voulait abattre utilise toujours la terreur pour se maintenir au pouvoir mais continue pourtant d’apparaître comme le garant de la stabilité sociale et politique…
Je sais que beaucoup de Syriens ont eu l’espoir qu’ils seraient soutenus par les gouvernements des pays européens, au début de la révolution, en 2011. Ils étaient très attentifs aux regards que les chefs d’Etats occidentaux portaient sur leur soulèvement et aux mots que ces derniers employaient pour décrire les exactions perpétrées par l’armée d’Assad. Au début, ils ne doutaient pas que la France, que les États-Unis, aideraient les Rebelles à en finir avec le régime qui les opprimait depuis déjà 40 ans. La désillusion a depuis longtemps tracé des sillons profonds dans les esprits.
Selon vous, les personnes migrantes qui entreprennent des voyages comme celui du personnage de votre livre, savent vraiment ce qui les attend ?
Elles savent qu’elles risquent la mort en traversant une mer ou un fleuve. Elles savent aujourd’hui qu’elles ne sont pas les bienvenues et que l’accueil sera rude. Qu’elles seront enfermées dans des centres voire dans des prisons. Que les démarches administratives seront longues et pénibles. Il se peut que, une fois ces démarches entamées, elles rencontrent des difficultés, des formes de conflits intérieurs ou de rejets plus complexes qu’elles ne l’avaient envisagé. Mais elles savent. Et si, malgré toutes les épreuves qui les attendent, elles s’engagent dans la traversée, je crois que c’est bien parce qu’elles ont la conviction de ne pas avoir le choix.
A votre avis, que pensent les personnes migrantes des habitants des pays vers lesquels elles se dirigent ?
Il y a sûrement autant de visions, de points de vue, de fantasmes qu’il y a d’individus prêts à tenter la traversée. Mais je peux rapporter ce que m’en ont dit quelques Syriens. Dans l’esprit de ces personnes, les Européens étaient particulièrement soucieux des droits de tous les êtres humains et même de tous les êtres vivants. Au moins dans un premier temps, elles ont fait une distinction rigoureuse entre le traitement qui leur était réservé, résultat des décisions de gouvernants, et le mode de vie des habitants occidentaux. Je ne suis pas certaine que toutes aient été déçues en arrivant, mais l’image qu’elles avaient de nous s’est forcément ajustée.
« J’admire et je soutiens celles et ceux qui portent secours, résistent et ne plient pas face à cet inadmissible argument-poncif de « l’appel d’air » que lancent régulièrement certains politiciens »
Quittons un instant votre livre. Quel regard portez-vous sur les actions des ONG qui tentent de débarquer dans les ports italiens, bien qu’elles n’y soient pas autorisées ?
J’admire et je soutiens celles et ceux qui portent secours, résistent et ne plient pas face à cet inadmissible argument-poncif de « l’appel d’air » que lancent régulièrement certains politiciens. Les attaques qui sont portées par les gouvernements européens contre SOS Méditerranée et d’autres ONG impliquées dans les sauvetages sont très dures. Le président de MSF-France parlait d’une politique de harcèlement judiciaire et administratif à l’égard de l’Aquarius qui a été mis hors d’état d’agir alors même qu’il avait permis de sauver des dizaines de milliers de vies.
Je vois en partie dans cette situation un écho à ce que je décris dans mon livre. Le nafar est celui qui est piégé dans un espace intermédiaire entre son lieu de départ et celui où il souhaite parvenir. En empêchant un navire de sauvetage d’accoster et en niant les besoins vitaux de ses passagers, on porte volontairement à son paroxysme cet état transitoire, d’attente, de vide, dans lequel on relègue les personnes dont on ne veut pas. L’Italie n’est pas la seule responsable. Elle est juste plus exposée géographiquement aux arrivées des demandeurs d’asile. Les pays du nord s’en lavent les mains.
Sur quels projets travaillez-vous après « Nafar » ?
Je porte un vif intérêt à ce qui est à la marge, à ce qui dévie. Je suis curieuse des individus qui ne trouvent pas leur place, et des groupes de personnes que notre société exclut. C’est sur ces champs d’exploration que je me penche encore.
« Nafar » de Mathilde Chapuis
Éditions Liana Lévi
160 pages – 15 Euros (11 Euros en version numérique)
(mathilde Chapuis – Photo DYOD PHOTOGRAPHY/OPALE/LIANA LEVI)