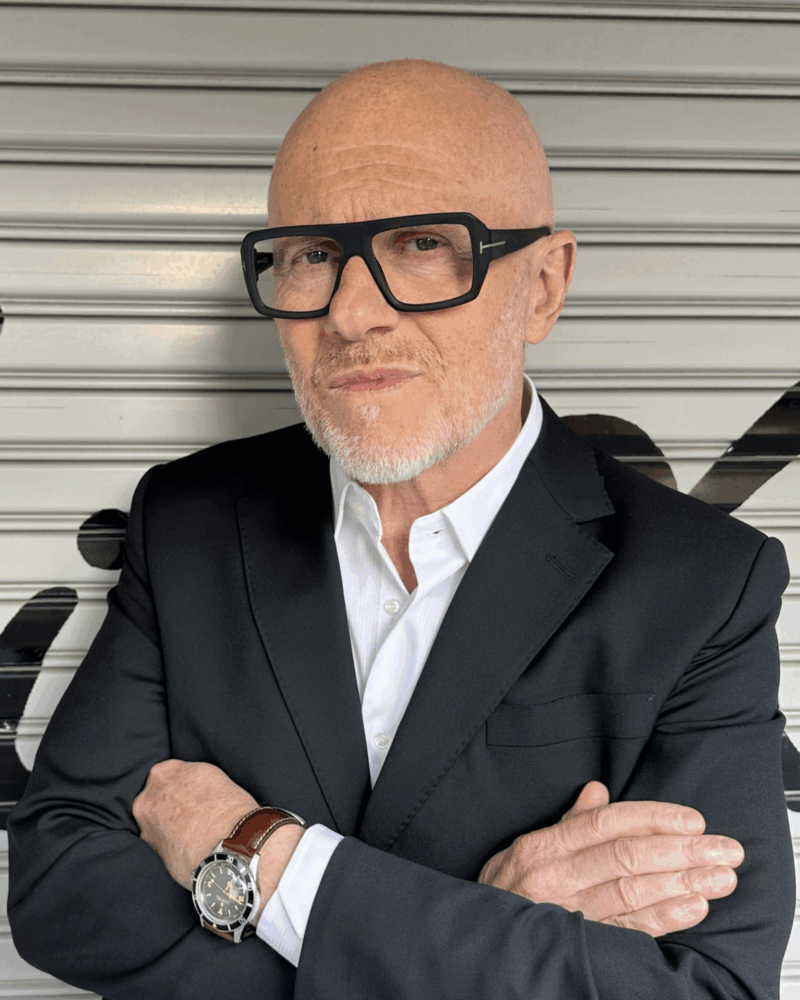Vous décrivez un retournement spectaculaire des grandes entreprises américaines, passées en quelques mois d’un zèle « woke » à un affichage assumé de valeurs conservatrices : ce basculement est-il sincère ou purement opportuniste, dicté par le rapport de force politique et économique instauré par Donald Trump ?
Depuis la fin de l’ère Biden, les entreprises américaines ont changé de posture à une vitesse étonnante. C’est un euphémisme. Les retournements de veste sont parfois saisissants : Amazon, Meta, McDonald’s, Disney… mais aussi PepsiCo, Netflix, KPMG, Deloitte, Citigroup, Walmart, Ford, Harley-Davidson, Toyota ou Salesforce. Wokes hier, anti-wokes aujourd’hui : la rapidité de ce basculement ne peut qu’interpeller.
Pour celles qui dépendent de l’État fédéral, directement ou indirectement, le virage est logique : leur marge de manœuvre reste réduite. Trump a multiplié les décrets et menacé de couper les subventions aux entreprises accusées de promouvoir, d’une façon ou d’une autre, l’idéologie qu’il combat avec acharnement : le wokisme. Pour les autres, en revanche, le retournement peut surprendre au premier abord.
Le pouvoir politique a changé et l’environnement est désormais plus favorable aux entreprises qui prennent leurs distances avec le wokisme. Il est toujours plus simple d’aller « dans le sens du vent ». Ce qui valait hier vaut encore aujourd’hui — et vaudra demain.
Les entreprises subissent des pressions fiscales, réglementaires et politiques. Il est même possible que certains dirigeants redoutent de voir leur responsabilité engagée. L’exemple de Mark Zuckerberg est révélateur : en août 2024, de son propre chef, il a reconnu devant le Congrès avoir cédé aux pressions de l’administration Biden pour censurer des contenus liés au Covid, mais aussi sur le genre ou l’immigration, puis avoir limité la diffusion d’un article sur Hunter Biden à la demande du FBI. Début 2025, Meta a supprimé son système classique de fact-checking aux États-Unis pour le remplacer par un modèle participatif (Community Notes) : ce sont désormais les utilisateurs eux-mêmes qui ajoutent des notes explicatives.
« Aller dans le sens du wokisme était devenu la norme. D’autant qu’avec la cancel culture, les entreprises redoutaient les campagnes de dénigrement capables de ruiner leur image en quelques jours »
Par ailleurs, il est important de souligner que ces restrictions — sur le genre ou l’immigration — ont été levées aux États-Unis, mais elles restent en vigueur en Europe en vertu du Digital Services Act (DSA). Tout cela ressemble à une manœuvre d’anticipation : Zuckerberg a senti le vent tourner avec le retour de Trump et a choisi d’adapter Meta en avance de phase.
« Business is business ! » L’intérêt des entreprises prime avant tout. Ce ne sont pas les considérations idéologiques qui déterminent leur stratégie. Logiquement. Pourtant, certaines comme Disney ou Netflix se sont affichées comme de véritables locomotives du wokisme. C’est peut-être ce qui interroge le plus : ont-elles cru à un basculement profond des attentes du public ? À une nouvelle tendance de fond pour laquelle il fallait non seulement être présentes, mais aussi pionnières ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec l’ère Biden, tout le monde a suivi. Il n’y a pas vraiment eu de rebelle parmi les grandes entreprises. Aller dans le sens du wokisme était devenu la norme. D’autant qu’avec la cancel culture, les entreprises redoutaient les campagnes de dénigrement capables de ruiner leur image en quelques jours. Une menace toujours d’actualité. Mais aujourd’hui, la chape de plomb idéologique qui pesait sur les acteurs économiques commence à se fissurer. Des brèches apparaissent et beaucoup s’y engouffrent.
La Bourse a salué des campagnes publicitaires résolument anti-woke, comme celle d’American Eagle : doit-on y voir un signe que les marchés financiers sont devenus les nouveaux arbitres de la guerre culturelle américaine ?
Parmi les entreprises qui se sont engouffrées dans la brèche, le cas d’American Eagle est emblématique. Géant du prêt-à-porter, la marque lance le 23 juillet 2025 une campagne publicitaire pour ses jeans, incarnée par l’actrice Sydney Sweeney. Le ton est clair : glamour, sensualité, séduction. Une publicité qui casse les codes désormais devenus traditionnels — visuels aseptisés, diversité obligatoire, inclusivité systématique.
Le succès est immédiat : dès le lendemain, l’action bondit de 10 %. Le 4 août, Donald Trump encense la campagne sur son réseau Truth Social et la qualifie de « the hottest ad out there » — « la publicité la plus osée du moment ». Résultat : le titre grimpe encore de 24 %, sa meilleure performance depuis vingt-cinq ans selon Bloomberg et le Wall Street Journal. Malgré les polémiques et les accusations d’idéalisme corporel, la marque ne recule pas : pas d’excuses, pas de retrait.
« Cette campagne a marqué une rupture : American Eagle a montré qu’il était possible de défier le conformisme ambiant et de résister aux intimidations. La cancel culture ne terrorise plus tout le monde, a priori… »
Cette campagne a marqué une rupture : American Eagle a montré qu’il était possible de défier le conformisme ambiant et de résister aux intimidations. La cancel culture ne terrorise plus tout le monde, a priori…
On s’était habitués à voir les Bourses saluer le politiquement correct. Avec American Eagle, ce ne fut pas le cas. Les marchés parient-ils sur un revirement pérenne ? Probablement. Le problème, c’est qu’il y a eu une grosse hypocrisie collective. Car en réalité, beaucoup en avaient assez du wokisme, quelles que soient leurs convictions politiques : analystes financiers, investisseurs, salariés, citoyens. Mais difficile de jouer les vilains moutons noirs, d’être le seul rebelle. Une fois qu’un acteur casse le jeu et ouvre une brèche, les autres suivent. C’est exactement ce qui se passe.
On peut très bien voter démocrate et refuser la théorie du genre, notamment l’idée que le sexe biologique n’aurait plus de rapport avec le genre masculin ou le féminin. On peut aussi en avoir assez d’être accusé de racisme quoi qu’on fasse, simplement parce qu’on est rangé dans le groupe des « dominants ». Ou être choqué par une plainte déposée contre un homme pour un simple regard jugé insistant. Les excès et les aberrations sont nombreux. Et aujourd’hui, les gens en ont assez — de tous bords, de tous milieux. Et le secteur boursier, bien évidemment, n’y échappe pas.
Vous soulignez que les politiques DEI ont parfois conduit à des discriminations inversées et qu’elles font désormais l’objet d’enquêtes fédérales : assiste-t-on selon vous à une véritable « criminalisation » du wokisme institutionnel aux États-Unis ?
On voit que l’autorité américaine des communications (FCC) enquête dans certaines entreprises — Disney par exemple — pour vérifier si les politiques DEI (diversity, equity, inclusivity) n’ont pas abouti à des discriminations inversées. Et c’est une évidence : derrière le mot equity — l’équité — se cache en réalité la discrimination positive. L’un des pans de l’idéologie woke.
Le marxisme opposait les bourgeois aux prolétaires, le wokisme oppose les « dominants » et les « dominés » — autrement dit, les « oppresseurs » et les « victimes ». Sont considérés comme « dominants » les individus blancs, hétérosexuels et cisgenres : les trois conditions doivent être réunies. Une personne cisgenre est celle dont le genre ressenti, féminin ou masculin, correspond à son sexe biologique. Les « dominés » regroupent plusieurs catégories : les minorités ethniques (Afro-Américains aux États-Unis, immigrés issus des anciennes colonies en Europe de l’Ouest), les minorités sexuelles (souvent rassemblées sous la bannière LGBTQIA+), et les femmes.
Avec le wokisme, plus vous êtes perçu comme « opprimé », plus on estime que vous devez bénéficier d’un traitement prioritaire. C’est ce qui conduit à la discrimination positive. Pour les wokes, cette logique construit un ordre social plus équitable et s’inscrit dans une démarche de réparation et de repentance : les « dominants » sont accusés de détenir des privilèges injustement acquis et sont donc jugés redevables envers les « dominés ».
« Avec le wokisme, plus vous êtes perçu comme « opprimé », plus on estime que vous devez bénéficier d’un traitement prioritaire. C’est ce qui conduit à la discrimination positive »
Le wokisme prétend lutter contre les discriminations, mais n’hésite pas à en créer de nouvelles. La discrimination positive est profondément injuste pour ceux qui en sont exclus : est-il juste d’être écarté d’une école ou d’une promotion simplement parce que vous appartenez au groupe des soi-disant « dominants » ? Elle est aussi terriblement humiliante pour ceux qui en bénéficient, car le doute plane en permanence sur leurs qualités réelles et leur mérite.
Parmi les raisons qui expliquent le changement de posture des entreprises américaines face au wokisme, il y a sans doute la peur des dirigeants d’être attaqués en justice pour discrimination. Comme dans l’immense majorité des pays occidentaux, les discriminations sont interdites et punies par la loi — aux États-Unis notamment par le Civil Rights Act de 1964. D’autant plus qu’en juin 2023, la Cour suprême a mis fin à l’affirmative action dans les universités, en quelque sorte l’ancêtre de la discrimination positive. Ce qui donne le ton général.
Curieusement, en mars 2025, la banque JPMorgan a officiellement rebaptisé son programme DEI (Diversity, Equity and Inclusion) en DOI — Diversity, Opportunity and Inclusion — remplaçant equity par opportunity (opportunité) afin de mettre en avant le principe d’égalité des chances…
« Le wokisme prétend lutter contre les discriminations, mais n’hésite pas à en créer de nouvelles »
Si les entreprises américaines s’alignent aujourd’hui sur l’air du temps conservateur, ne risquent-elles pas demain de reproduire la même logique de soumission idéologique qu’hier, mais dans l’autre sens — en se contentant de suivre le pouvoir en place ?
Non, car le wokisme est loin d’être mort. Les progressistes n’ont pas disparu : dans les grandes villes démocrates – New York, San Francisco, Seattle… –, dans des médias encore très ancrés à gauche, et dans les États sous gouvernance démocrate, la contre-offensive s’organise bel et bien. Les manifestations, les campagnes de harcèlement en ligne, les protestations se poursuivent, preuve que la cancel culture reste active, même si elle a perdu une partie de son pouvoir d’intimidation.
Parallèlement, on assiste à l’affirmation d’une véritable culture anti-woke, portée par un public conservateur qui investit le débat public, et pas seulement l’électorat de Trump. Le clivage entre progressistes (majoritairement démocrates) et conservateurs (majoritairement républicains) est structurel au paysage américain : il a toujours existé et perdurera.
Cette polarisation a renforcé les deux camps, rendant la parole et les actions plus décomplexées. Mais une chose est sûre : on ne reviendra pas à une situation de monopole idéologique comme celle qu’on a connue récemment avec le wokisme. Les entreprises s’y sont soumises, de gré ou de force, même quand cela allait à l’encontre de leurs intérêts. L’élection de Trump leur a donné une bouffée d’oxygène. Car les entreprises sont là pour faire du business, pas pour servir de relais à un mouvement idéologique, aussi puissant soit-il.
Aujourd’hui, le champ des possibles s’élargit. Le cas d’American Eagle fait figure de jurisprudence : il montre qu’une autre voie est ouverte. Les entreprises répondront davantage à la demande de leurs clients. Les valeurs conservatrices ont le vent en poupe, il y a un marché à conquérir, longtemps ignoré, voire méprisé. C’est révélateur du poids du conformisme.
Les publicités sont devenues standardisées, insipides, cherchant moins à séduire qu’à donner des leçons de morale. Les publicitaires ont renoncé au beau, obsédés par l’idée de cocher toutes les cases de l’inclusivité et de la diversité. Or, nombreux sont ceux qui veulent voir des publicités où la beauté et la séduction ne sont pas considérées comme discriminatoires.
Les entreprises américaines vont saisir l’opportunité de s’extraire du joug du wokisme. Et il y a fort à parier qu’elles n’auront pas envie de revenir de sitôt à l’état de soumission qui fut le leur. Le vent de la liberté souffle sur elles. Mais il faut rester lucide : elles garderont forcément une part d’opportunisme. La différence avec hier, c’est qu’elles ne peuvent plus se contenter d’obéir à une seule idéologie dominante.
« Une chose est sûre : on ne reviendra pas à une situation de monopole idéologique comme celle qu’on a connue récemment avec le wokisme. Les entreprises s’y sont soumises, de gré ou de force, même quand cela allait à l’encontre de leurs intérêts »
Ce basculement du progressisme vers le conservatisme aux États-Unis vous semble-t-il annoncer une reconfiguration durable de l’imaginaire collectif occidental, ou bien n’est-ce qu’une parenthèse liée à la victoire de Trump, amenée à se refermer avec un changement de majorité ?
Ce qui se passe aux États-Unis ne relève pas d’une simple parenthèse électorale mais d’une tendance probablement durable. Nous sommes entrés dans une véritable guerre idéologique : progressistes contre conservateurs, mondialistes contre souverainistes. Deux visions irréconciliables s’affrontent désormais, et elles structurent la société américaine comme la société occidentale dans son ensemble.
Le poids du politiquement correct a fini par devenir étouffant. Il s’impose entre autres dans les médias, dans l’éducation, dans les entreprises, dans les institutions, au détriment de la liberté d’expression. C’est cette chape idéologique qui a provoqué une réaction de rejet, bien au-delà de l’électorat conservateur. On assiste à une réhabilitation de valeurs jugées essentielles : le mérite, la liberté de penser, le libre arbitre, le droit de ne pas se soumettre à une norme unique. Les lois liberticides, adoptées sous couvert de « bonnes intentions », sont légion. Les démocraties occidentales semblent s’éloigner dangereusement de l’idéal démocratique.
Les États-Unis ont toujours été un laboratoire culturel pour l’Occident. Ce qui s’y joue aujourd’hui annonce inévitablement des répercussions en Europe. C’est donc une recomposition profonde et durable de l’imaginaire collectif qui est à l’œuvre, et non une simple alternance liée au retour de Trump.