Une première question d’introduction : pourquoi avoir choisi de venir vivre en France ? Etait-ce une volonté personnelle ou plutôt une nécessité par rapport à votre travail de dessinateur ?
Depuis ma petite enfance je constate que la France et l’Europe m’ont toujours fasciné. Pour moi, la France était un lieu mystérieux rempli d’art, de poésie, et beauté. Par la suite, jeune adulte j’ai profité de la première occasion pour venir «enquêter» sur place moi-même: je me suis inscrit aux Beaux-arts de Paris, j’ai trouvé une place dans le Choeur de l’Orchestre de Paris le soir, et je me suis mis à explorer la ville de fond en comble, déterminé à découvrir ce que Paris pouvait m’apprendre. Aujourd’hui je vis et je travaille en France et ce lieu continue de nourrir mon imaginaire au quotidien. Et même si j’ai un regard un peu plus circonspect sur mon pays d’adoption je continue à me sentir stimulé, inspiré après toutes ces années.
Je pense que tout cela s’exprime dans mon dessin. En effet, mes premières collaborations professionnelles ont découlé, presque naturellement, de cette affinité que je ressentais dès mon arrivée ici en Europ. Hormis un séjour de huit ans à Los Angeles dans les années 1990 (au bout d’un moment j’ai eu un peu le mal de pays quand même !) j’ai toujours senti que ma vie personnelle et professionnelle était plus riche et plus stimulante ici en France que dans mon pays de naissance. Je reste très attaché aux Etats-Unis et j’y travaille souvent, mais sans parler de l’aspect familial qui représente certainement mon plus fort lien avec la France. L’évolution de mon activité artistique confirme cet attachement hexagonal.
Avec une carrière qui s’étend à l’international, je préfère nouer des collaborations américaines depuis l’Europe. Outre les questions d’affinité culturelle, il faut reconnaître que j’ai maintenant — après 30 ans d’activité — des liens avec des éditeurs, des auteurs que j’admire, des consoeurs et confrères artistes ici en Europe qui me manqueraient cruellement si je devais m’éloigner. Il faut dire aussi que, d’une façon générale, je pense qu’il est plus facile de travailler avec les Etats-unis depuis la France que l’inverse. Dans mon expérience, les liens personnels avec mes amis auteurs, éditeurs, galeristes, lecteurs, collectionneurs sont d’une grande importance et font que le métier d’artiste tel qu’il se pratique en France reste une profession basée sur le relationnel, la convivialité où le contact humain constitue un élément clé de l’évolution professionnelle. A mes yeux, cet aspect fondamentalement humain de notre profession fait que je reste, après toutes ces années d’activités, tout aussi inspiré par le travail que je fais mais aussi par ceux qui le font autour de moi.
Dans la loterie, vous avez adapté la nouvelle de votre grand-mère, Shirley Jackson. Qu’est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ?
Bonne question ! A vrai dire, ce n’était pas un choix facile car cette nouvelle représente pour beaucoup de ses lecteurs son véritable chef d’oeuvre et la pression de réussir l’adaptation était très forte ! C’est une nouvelle très connue aux Etats-unis, lue souvent dans les lycées et universités, considérée comme un modèle de fiction courte.
De plus, cette année marque le centenaire de la naissance de Shirley Jackson et son oeuvre reçoit actuellement beaucoup d’attention médiatique. J’avais l’envie de faire quelque chose autour de La Loterie depuis un moment, et le moment semblait propice. Son éditeur historique aux Etats-unis, Farrar, Straus & Giroux, a accepté l’idée un peu audacieuse d’une adaptation graphique de sa nouvelle la plus célèbre. Par coincidence, mon éditeur ici en Europe, Casterman m’invitait à considérer un projet dans le même esprit, donc on va dire que c’était la confluence de plusieurs choses qui m’a encouragé à sauter le pas et de tenter cette adaptation avec un soutien translatlantique.
Quels ont été les principaux défis à relever pour élaborer la trame narrative de cette nouvelle en bande dessinée ?
C’est un exercice délicat, car cette nouvelle fonctionne avec une logique narrative assez particulière, une structure précise et très économe qu’il faut absolument laisser intacte, car sans elle, on risque de perdre une grande partie de la puissance du récit. Pour moi, le défi principal était de trouver le «langage graphique» qui me permettrait de raconter l’histoire de La Loterie visuellement tout en gardant ses ambiguïtés, et surtout sans dévoiler les mystères de la nouvelle d’origine. Une bonne adaptation doit réussir un équilibre qui semble parfois un peu périlleux: il faut rester fidèle à l’histoire d’origine tout en favorisant un processus créatif dynamique, audacieux, qui réussit à prendre quelques libertés innovatrices avec le texte d’origine. C’est ce «cocktail» particulier qui permet d’arriver à quelque chose qui fonctionne vraiment en tant que bande dessinée. Le tout était de suivre mon instinct créatif personnel en respectant le mécanique original, très efficace de cette nouvelle tout aussi ingénieuse que troublante. Ce n’était pas toujours facile, mais je pense que l’exercice a porté ses fruits.
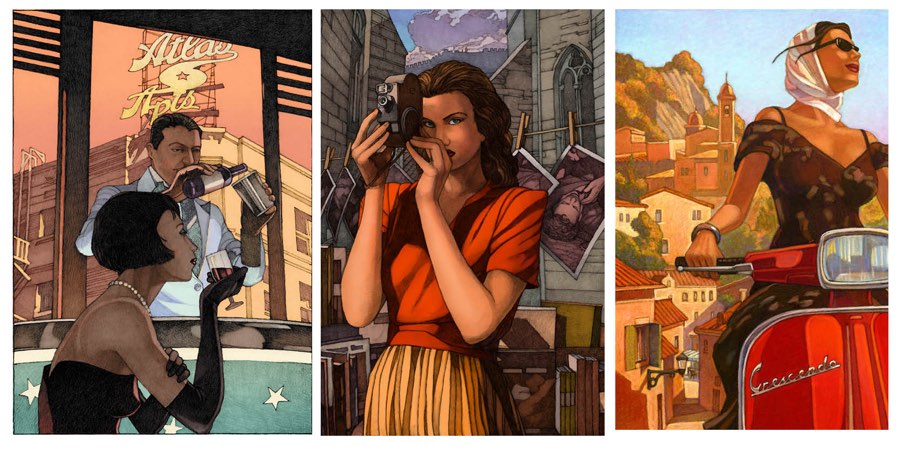
Dans une interview publiée sur le site de Casterman, vous dites à propos du village qui constitue le décor de La Loterie que vous avez « réinventé une Amérique presque prototypique ». Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Ma grand mère a toujours évité de préciser où se situait l’action de La Loterie, maintenant un certain mystère autour de cette question parce qu’elle voulait que ses lecteurs puissent imaginer que le village en question leur était familier, connu et proche. De mon côté, en tant qu’adaptateur graphique, il fallait absolument developper cette qualité dans mes dessins. D’où ma volonté de chercher des inspirations architecturales précises pour le village représenté — des inspirations qui se focalisent sur la Nouvelle Angleterre sans qu’on puisse fixer un endroit précis. L’auteur nous donne tout de même pas mal d’indices quant au lieu du drame : le fait que le village soit bâti autour d’un square nous laisse penser qu’il date de l’époque coloniale, ou d’avant l’arrivée de la voiture en tous cas, époque où «Main Street» devenait le centre de la vie civique au lieu de la place villageois traditionnel. Quant à l’architecture, je souhaitais mettre en évidence un style inspiré de l’architecture «Shaker» — des angles droits, sobres voire austères car je trouve que cette architecture colle bien avec l’esprit de la nouvelle et de ses personnages.
Vous poursuivez en disant que « vous avez joué à l’ethnologue en étudiant la population du village de votre enfance. » Comment avez-vous appréhendé la mise en scène des personnages et des décors ?
Là il fallait faire attention et vraiment trouver la bonne piste, car je voulais à tout prix maintenir ce manque de spécificité quant au lieu et ses habitants tout en donnant au lecteur graphique le sentiment de se trouver en terrain connu parmi des voisins potentiels, comme si n’importe qui — même celui qui ne connait les Etats-Unis qu’à travers le cinéma — puisse imaginer que ce village soit basé sur un lieu bien réel. C’est très important car le lieu — les maisons, les champs, le village lui même — est presque un personnage du récit. N’oublions pas que l’activité agricole des villageois et l’importance qu’elle tient pour eux est à la base de leurs croyances, le moteur de cette barbarie, la force qui permet à cette cérémonie étrange et brutale de perdurer année après année ! Le village et le paysage qui l’entourent sont omniprésents, le décor d’un théâtre où se joue un drame tout à fait particulier.
Parlons à présent des pauses graphiques dans le récit. En quoi était-ce important à vos yeux ?
Je développe ma réponse précédente: la nouvelle contient en tout et pour tout onze pages de texte, alors que mon adaptation graphique en compte 135 à peu près. Je voulais à tout prix que la version graphique de La Loterie prenne son temps et puisse développer pleinement l’atmosphère, la palette et la lumière. Ce choix me semblait important pour deux raisons: d’abord en commençant avec une certaine lenteur on est peu à peu pris dans le jeu, prisonnier d’une lente accélération qui nous mène jusqu’à la fin dans un rythme qui devient de plus en plus frénétique et où les actions se suivent avec un rapidité qui souligne la brutalité des évènements. Mais ensuite ce choix de pauses graphiques dans le récit nous donne aussi une première phase qui berce le lecteur, lui donne une fausse impression de tranquillité. Nous nous sentons presque «chez nous» dans les premières pages de l’album, nous promenant dans ce village qui — aux premiers abords au moins — nous semble anodin, banal, familier. C’est un choix fait pour tirer un contraste clair avec la fin qui doit vraiment choquer le lecteur, ce choc qui doit sembler d’autant plus inattendu qu’il a lieu dans un décor qui avait toutes les qualités d’un quotidien «sans histoires».

Pourquoi avoir souhaité partager la nouvelle de votre grand-mère avec le lectorat francophone ?
Comme j’ai dit auparavant cette histoire a une certaine réputation aux Etats-unis mais j’ai toujours été un peu frustré qu’elle ne soit pas mieux connue ici en France car je trouve qu’elle mérite de l’être. On connaît un peu mieux les romans de Shirley Jackson en France depuis quelques années, ceci dit — surtout maintenant qu’on retrouve deux excellentes re-publications de ces romans «La Maison Hantée» et «Nous avons toujours vécu au château» chez Rivages, avec tout le soin donné aux traductions qu’on connaît de cette prestigieuse maison d’édition. Ce projet était donc pour moi l’occasion de me servir des «outils» graphiques que j’ai mis au point avec des adaptations en BD comme celles de «Nuit de Fureur» de Jim Thompson et bien «Le Dahlia Noir» de James Ellroy, et d’imaginer cette version graphique d’une nouvelle qui me tient tant à coeur pour des raisons personnelles et familiales. Avec un peu de chance cette aventure va donner envie au public français de découvrir davantage les fictions courtes de cet auteure, car malgré toute l’admiration que j’ai pour ses romans, je trouve que c’est dans les formats courts qu’elle brille vraiment.
Quelles sont les contraintes d’un huis clos comme celui dans lequel se déroule votre bande dessinée ?
Dès qu’il s’agit de faire 135 pages de bande dessinée — soit près de 400 cases ! — dans un seul décor, un dessinateur sait qu’il va falloir être créatif du début du récit jusqu’à la fin s’il ne veut pas perdre l’attention de ses lecteurs. Il faut constamment innover, varier, renouveler le décor afin de donner aux lecteurs une expérience aussi stimulante que la nouvelle d’origine. Heureusement c’est précisément le genre de défi que j’adore, et je me suis bien amusé à jouer avec toutes les options graphiques à ma disposition, variant en permanence les angles, les cadrages, l’alternance des compositions rapprochées et les détails avec des plans plus larges sur l’action au fur et à mesure qu’elle se déroule. Cette qualité du récit, ou toute l’action a lieu dans un décor unique, était certes l’une des choses qui m’a fait hésiter avant de me lancer dans l’adaptation, mais elle est vite devenue une sorte de «challenge» presque jubilatoire et j’ai adoré contourner ce aspect de la nouvelle que certains considéreraient comme une contrainte pour en faire une véritable qualité dans le contexte de l’album.
Comment avez-vous réfléchi à votre travail graphique afin de mettre en valeur le suspens et la tension de la trame narrative ?
Excellente question, et je dois dire qu’elle se pose en réalité avec chaque nouvelle adaptation, car il est clair que le travail graphique réalisé pour un roman d’Ellroy ou de Jules Verne ne va pas être le même que pour d’une nouvelle de Shirley Jackson. Sans changer vraiment de style d’un projet à l’autre, je cherche avec chaque nouvelle adaptation à faire un certain nombre de petits «réglages» par rapport à mon approche graphique, de façon à mettre en valeur certains éléments visuels qui, me semble-t-il, coïncident et renforcent les choix stylistiques de l’auteur et du texte que j’ai devant moi. Dans le cas de La Loterie je voulais explorer pleinement la tension qui s’installe peu à peu parmi les villageois au fur et à mesure que le rituel progresse, focalisant notamment sur les détails — les mains, les regards, les expressions un peu éteintes des personnages, les détails anodins qui, étant donné les circonstances, peuvent faire durer et intensifier la tension de la nouvelle car nous, le lecteur, on est toujours un petit peu en manque d’informations par rapport à ce qui s’y passe. Il est important qu’il soit difficile d’identifier la source de l’angoisse qui monte inexorablement au fur et à mesure que l’histoire progresse. Le langage de Jackson est volontairement dépouillé, simple, parfois laconique (c’est un caractéristique historique des habitants de la Nouvelle Angleterre, ce qui rend ce choix particulièrement juste); il fallait que les dessins fonctionnent sur le même longueur d’onde, en quelque sorte. En limitant les informations «utiles» communiquées par les dessins, on est en permanence légèrement déboussolé par rapport au déroulement de la cérémonie, et surtout par rapport à l’enjeu de celle-ci, confusion qui est volontaire voire essentielle si la nouvelle veut remplir sa mission. C’était important que les dessins ne racontent ni plus ni moins que le langage de la nouvelle d’origine, d’où ce choix.
Vous avez opté pour l’adoption d’une nouvelle et pas d’un roman de Shirley Jackson. Pourquoi ce choix, Miles Hyman ?
Ma grand mère avait une grande maîtrise de la fiction courte. Ses nouvelles ont toujours été les oeuvres que je préfère chez elle, c’est là où son écriture est vraiment efficace, voire magistrale. En plus, j’aime bien pouvoir élaborer l’action d’un récit, alors qu’en contraste l’adaptation d’un roman nous met face à un travail d’élagage permanent et on finit souvent par sacrifier les petits passages où il ne se passe peut-être pas grand chose mais qui sont pourtant important par rapport à l’esprit de l’oeuvre littéraire original. Ces problèmes là se posent moins avec une nouvelle où l’adaptateur peut vraiment explorer chaque aspect de la fiction, c’est un travail de réflexion beaucoup plus méticuleux et qui me correspond mieux.
On imagine que l’approche graphique des personnages et notamment de la foule a du être un travail important pour parvenir à ce rendu. Est-ce le cas ?
La plupart des personnages de La Loterie ne sont pas tant des personnages classiques, avec des pensées, un passé, des sentiments mais plutôt des stéréotypes, des présences symboliques; on a quasiment aucun accès à leurs émotions, leur réflexions, leur motivations. Comme pour le village, les habitants de ce lieux doivent rester «génériques», car ils sont (sur un niveau purement allégorique) des représentations d’un «tout le monde» universel. C’est délicat comme exercice dès qu’il s’agit de traduire ces personnages à une lecture visuelle: d’une manière générale, dès qu’on voit les personnages dessinés on ressent un besoin naturel de les «identifier», de chercher à comprendre l’élément humain qui nous rapproche d’eux pour mieux comprendre leur motivations.
Il s’agit là d’une différence importante entre une narration verbale et une narration visuelle/graphique. Je reste persuadé que la lecture d’un texte classique et une lecture visuelle d’un récit engagent des parties du cerveau différentes, qu’on interprète les informations narratives d’une façon très différente d’un format à l’autre. Il a donc fallu jongler en permanence avec la présence visuelle des personnages tout en limitant ce qu’ils expriment, car permettre une identification trop spécifique avec l’un ou l’autre d’entre eux créerait un contre-sens par rapport au fonctionnement de la nouvelle de départ. Par contre, je me suis permis de developper un peu plus des personnages de la famille Hutchinson, personnages clé de l’histoire, car ils sont les acteurs principaux de la bande dessinée et donc des repères importants. Les lecteurs doivent pouvoir s’identifier avec eux car autrement cela nuirait au fonctionnement de la nouvelle graphique.
On a parfois l’impression que la foule est un personnage à part entière. ESt-ce que cette impression est bonne ?
En effet on est en présence de quelque 300 personnes, mais avec une douzaine seulement qui «compte» dans le contexte de l’action de la nouvelle. Pour les autres, même si l’on voit clairement certains individus par moment, on ne doit pas ressentir le besoin de les identifier — ils doivent maintenir leur qualité générique à tout prix pour que la nouvelle se déroule correctement. La foule, surtout à la fin, doit rester cohérente, massive comme un bloc d’humanité qui se comporte comme un tout, par automatisme, sans réfléchir. J’ai donc décidé de les dessiner ainsi, comme en noeud d’humanité sans spécificité, des individus dont la manque de personnalité individuelle rend les actions réalistes dans le contexte du dénouement de l’histoire. S’ils n’ont pas de personnalité ils ne peuvent pas être contraints de réfléchir sur leurs actes, de ressentir de la culpabilité, par exemple, par rapport à cette chose brutale qu’ils font chaque année sans s’interroger sur l’utilité, les justifications de leur acte. C’est donc précisément cette qualité d’anonymat donnée à la foule qui rend crédible le choc final de La Loterie.
Quelle part accordez-vous au réalisme dans votre dessin ? Vous dites même que c’est quasiment documentaire dans une interview accordée de nos confères d’ActuaBD.
Lorsque les lecteurs du New Yorker ont découvert cette nouvelle dans le numéro de juin 1948 les réactions étaient presque aussi surprenantes que la fin de l’histoire elle-même! En relisant un certain nombre de lettres des lecteurs effrayés, choqués — voire en colère pour un certain nombre d’entre eux — une chose est particulièrement saisissante: beaucoup d’entre eux pensaient que La Loterie n’était point une fiction mais un reportage. Certains allaient jusqu’à demander où se passerait la prochaine cérémonie décrite par la nouvelle, avides de pouvoir s’y rendre pour l’édition de 1949 ! Je me suis beaucoup intéressé à ces réactions-là en particulier dans le contexte de mon adaptation, m’interrogeant sur les qualités de la nouvelle qui pouvaient laisser croire aux qualités documentaires du style de ma grand mère; pour mieux souligner cet aspect de la fiction, j’ai décidé de mettre au point une approche graphique aussi réaliste que possible — sans aller jusqu’à un réalisme «photographique», bien entendu. Je cherchais à installer une lecture visuelle qui pouvait éventuellement laisser croire que mes dessins étaient inspirés d’une réalité observée, tout comme le texte d’origine laissait planer cette même ambiguïté pour ces premiers lecteurs du New Yorker en 1948.
Pour coller à l’époque, avez-vous entrepris des recherches historiques sur cette période ?
Tout à fait. D’ailleurs je mène d’importantes recherches avec chaque nouveau projet, cela fait partie pour moi d’une démarche globale car je cherche toujours à enrichir mon dessin avec autant d’influences, allusions, références que possible — sans pour autant perdre la nature de mon propre style de dessin, bien sûr. Cette recherche est pour moi très stimulante : d’une part, j’adore apprendre des nouvelles choses, découvrir des éléments inconnus qui peuvent trouver leur place dans mon dessin, un détail subtil qui va rajouter un sens inattendu à une composition, un personnage, un décor. D’autre part mon goût personnel va vers un dessin plutôt riche en références, une densité qui donne aux lecteurs l’impression qu’il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. La loterie me donnait l’occasion d’approfondir ma familiarité avec des lieux que je connais «par coeur» puisque j’y ai grandi; et pourtant en fouillant dans des archives, des vieilles photos, des gravures et toute sorte de sources parallèles, j’ai fini par me sentir en terrain totalement exotique, un sentiment assez rafraichissant car cela confirme ma conviction que le quotidien, le familier est une source inépuisable de surprises et d’étonnement.
Pour terminer, quelle est le regard que vous portez entre l’univers éditorial de la bande dessinée aux USA et en Europe ? Sont-ils différents ?
J’ai grandi avec Mad magazine et les comics américains, mais j’étais vite intrigué par la bande dessinée franco-belge dès qu’on avait la possibilité d’en trouver aux Etats-unis, c’est à dire dès le début des années 1970. Je faisait une sorte de pèlerinage semi-annuel à La Librairie de France à Rockefeller Center à New York, achetant des albums de Hergé même avant qu’ils ne soient traduits en anglais (peut-être une explication parmi tant d’autres pour ma fascination avec la langue française…!). Tout cela a bien évolué depuis quarante ans: j’ai une admiration immense pour certains compatriotes comme Charles Burns, Chris Ware, Daniel Clowes (pour n’en citer qu’eux…) mais j’ai tout autant d’admiration pour des auteurs européens comme Loustal, Mattotti, De Crécy, Gôtting, Blutch, etc. Je trouve que, ici en Europe à l’heure actuelle, nous sommes en train de vivre une sorte d’âge d’or de la créativité dans le monde de la bande dessinée, et j’estime avoir une chance inouïe d’y assister de si près.
Après c’est vrai qu’il y a les considérations éditoriales qui rentrent en jeu, celles qui déterminent comment l’on travaille et les différences en termes de liberté et de créativité d’un côté de l’Atlantique ou de l’autre (sans parler de l’Asie avec l’immense influence des mangas sur la bande dessinée contemporaine mais qui ne fait pas partie de mes lieux de travail). J’ai souvent dit que le travail entre dessinateurs et éditeurs aux Etats-unis est bien plus cadré, plus formaté que celui fait avec mes éditeurs français et belges.
En général c’est mon expérience qu’une collaboration américaine sera plus étroitement cadrée que celle qui se déroulera en Europe, et il s’agit là d’une des raisons pour lesquelles j’ai tendance à préférer mes collaborations européennes. L’on a tendance à me laisse plus facilement assumer mon rôle d’auteur à part entière ici en Europe, sans entrave ni conditions, respectant mes choix et mes envies avec la conviction que cette liberté permet une démarche créative qui correspond aux attentes du public de bd et d’art graphique.
Ceci étant, pour la réalisation de la La Loterie, qu’il s’agisse de mon éditeur américain ou de Casterman ici en Europe, le travail a été très fluide, très facile, avec un grand respect de mes choix de mes envies. Bref, c’était vraiment un projet réussi d’un bout à l’autre!
LA LOTERIE
Miles Hyman
Editions Casterman
168 pages
23,00 euros
Le site officiel de Miles Hyman
Lire aussi dans nos grandes interviews de bande dessinée :
Saint-Barthélemy : une page sombre de l’Histoire de France en bande dessinée
Tommy Redolfi : le portrait fantasmé de Marilyn Monroe
