De 1990 à 1993, il devient Administrateur Général de la Comédie Française puis à son départ du Français crée la Compagnie Pour Mémoire et retrouve son poste de professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Riche de l’expérience de plus de 140 mises en scène d’auteurs classiques et contemporains, sa passion du théâtre est intestine et sans compromis. Avec le soutien de Jean-Marie Besset, directeur du CDN montpelliérain et d’ Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville à Paris et après sept ans de démarches vaines, il a enfin eu l’opportunité de monter Loin de Corpus Christi, une « pièce cinématographique » de Christophe Pellet qui raconte les destins croisés de plusieurs femmes , Norma Westmore , Anne Wittgenstein, Kathleen Sebban-Neal et Clara Hoffer, qui choisissent la fuite du réel et le fantasme de l’image pour échapper à la réalité décevante de l’Histoire du XXème siècle mais aussi de leur histoire personnelle. En parallèle, la présence de quatre personnages masculins – dont deux ayant réellement existé ( Bertolt Brecht et Richard Hart) – qui sont ,pour les plus jeunes, des êtres manipulés, tandis que les autres ,plus âgés, ont une vision lucide qui leur offre simplement la possibilité de désespérer. Loin de Corpus Christi est une pièce passionnante à mettre en scène tant elle cumule les difficultés, avoue en plaisantant Jacques Lassalle. Sa densité romanesque, sa structure en séquences, sa part philosophique dans les monologues en font un défi que relève avec modestie, enthousiasme et pertinence un grand Monsieur du Théâtre que nous sommes très heureux de recevoir ce mois-ci !
Quand on lit votre « postface », on constate la grande connaissance que vous avez de l’oeuvre de Christophe Pellet….
Paradoxalement, je ne connaissais pas du tout le théâtre de Christophe Pellet quand je l’ai travaillé pour la première fois.
Vous aviez déjà proposé une représentation de Loin de Corpus Christi lors d’un festival à Limoux pourtant, non?
A l’époque où Jean-Marie Besset dirigeait le festival NAVA à Limoux,sa ville natale, j’avais déjà fait une mise en espace de Loin de Corpus Christi sans connaître le travail de l’auteur. Ce festival original consiste à choisir des pièces contemporaines, souvent qui ne sont pas encore publiées et à en proposer une mise en espace, concept très variable selon qui en a la responsabilité : certains se contentent d’une lecture publique un peu dramatisée. D’autres comme moi font une mise en espace. Ce n’est pas moi qui aie l’initiative du texte et de la distribution,j’ai un regard évidemment dessus et je n’accepte pas tout mais je me laisse guider et c’est un sentiment agréable. Je demande beaucoup aux acteurs puisque même s’ils ont en main leur partition, je veux qu’ils aient la même liberté de jeu que s’ils savaient leur texte.C’est un petit défi personnel qui m’amuse beaucoup, je suis le doyen du festival et j’y ai fait, je crois, sept mises en espace. L’enjeu de ce festival est d’essayer de trouver un « après »à ce qui a été l’esquisse d’une création. C’est là-aussi un sujet très dangereux car parfois on est tellement heureux du résultat de ces 8 jours de travail qu’on se dit que peut-être en deux mois on fera moins bien…le théâtre est une chose si complexe…A partir de cette mise en espace, l’Arche a publié le texte en s’inspirant pas mal de cette version scénique et en me demandant cette postface. A ce moment-là, j’ai lu toute l’oeuvre de Christophe Pellet et j’ai produit ce texte de mise en perspective générale.
Que s’est-il passé entre Limoux et aujourd’hui pour ce projet?
Sept ans sont passés avec un insuccès total. J’ai envoyé ce texte à tous les centres dramatiques nationaux et scènes nationales (une vingtaine). Je vais vous faire l’économie de ce que je pense du devenir du théâtre de service public! Quand j’étais administrateur de la Comédie Française, je ne laissais jamais passer certains textes : je le faisais moi-même ou Bernard Dort ou Jean-Loup Rivière qui étaient mes conseillers littéraires le faisaient. Sept ans…grâce à l’obstination de Jean-Marie Besset et le fait qu’il ait maintenant un outil de travail , Emmanuel Demarcy-Mota, moi-même et ce qu’il reste de ma compagnie, – puisque les anciens serviteurs du théâtre français, quand ils se sont bien conduits on leur laisse une compagnie. Ma compagnie se nomme la Compagnie Pour Mémoire car lorsque j’ai quitté le Français dans des conditions un peu douloureuses et polémiques, j’avais envie d’arrêter et l’on m’a poussé à continuer: j’ai donc voulu laisser dans le nom de ma compagnie un souvenir de cela.C’était en 1993. Je ne me suis jamais battu autant pour un projet que pour Loin de Corpus Christi, je n’avais d’ailleurs jamais frappé à une porte auparavant et ce fut avec un insuccès total…
Qu’est-ce qui vous a immédiatement séduit à la lecture de Corpus Christi? Vous souvenez-vous de vos premières impressions?
C’est un scénario qui trouve les voies d’un texte dramatique mais avec des ingrédients qui sont essentiellement un matériau filmique, aussi bien sur le plan dramatique que sur le plan structurel de la composition de la pièce : l’écriture, le mélange des genres. Il y a 32 séquences: je dis bien séquences et pas scènes . La première difficulté est de trouver un espace suffisamment réaliste qui permette d’évoquer des moments si différents que la période maccarthyste d’Hollywood en 45/47 à la fin de la seconde guerre mondiale, au moment où le fascisme menace l’Amérique,la Guerre de Corée, la Guerre Froide, la Chute du Mur de Berlin ( de 1988 à 2001) côté Berlin Est, ou encore le Paris d’une jeune femme qui travaille à la cinémathèque et qui a pour ami un critique -assez vite repérable sous l’anagramme de son nom – et la pièce se termine même en 2024 se projetant dans un avenir virtuel. Comment trouver une réponse qui préserve, de façon très lisible pour le spectateur, cette liberté d’organisation, cette liberté spatiale et temporelle de l’action et, en même temps, trouver une forme très fluide, très légère? En effet, les lieux et les périodes de chacune de ces séquences sont totalement entremêlés, la chronologie est totalement chamboulée. Je crois qu’on est en bon chemin mais cela demande un travail énorme puisqu’il faut traiter chaque séquence pour elle-même avec un espace, un rythme, une lumière puis ensuite faire en sorte que ces trente-deux séquences, entrecoupées par un entracte – puisque la pièce comporte deux parties – soient liées et que l’on se sente ainsi au cinéma dans un théâtre.
Si l’on évoque maintenant l’écriture de l’auteur. Vous dîtes dans cette postface que les textes de Christophe Pellet n’ont pas pour « objectif suprême une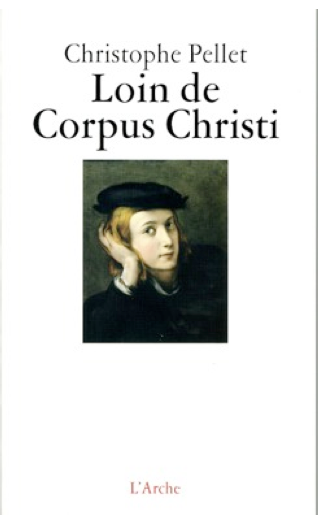 refondation de la parole en d’hasardeux laboratoires » ; ils ont tout de même une densité, une épaisseur romanesque qui doit être déstabilisante pour le comédien et son metteur en scène, non?
refondation de la parole en d’hasardeux laboratoires » ; ils ont tout de même une densité, une épaisseur romanesque qui doit être déstabilisante pour le comédien et son metteur en scène, non?
Ce qui m’a séduit, c’est évidemment la potentialité cinématographique de ce texte dramatique mais également sa potentialité romanesque, c’est à dire le foisonnement des actions, l’entrelacement des personnages, des histoires et des thèmes. Après- et comme plaisir et comme défi- l’écriture.
Êtes-vous un habitué des textes contemporains?
Je ne suis pas un spécialiste de l’écriture contemporaine mais j’aurais quand même monté dans ma carrière une bonne quinzaine d’auteurs contemporains et puis j’écris aussi des textes: la question de l’écriture est donc au coeur même de ma vie. Je suis frappé par beaucoup de jeunes auteurs qui refusent évidemment le modèle aristotélicien : un texte, une action dramatique, des personnages, un dialogue, un découpage de scènes, une progression chronologique. Aujourd’hui, certains considèrent que raconter une histoire est du temps perdu, je n’en suis pas. Certains disent que les personnages sont des notions psychologisantes et sociales et qu’on s’en moque; il n’y a plus de personnages constitués; il y a des voix. Il n’y a plus de dialogue: c’est une écriture qui balance entre le monologue intérieur avec la pluralité des voix au sein du dialogue…une rhapsodie. Tout ça m’intéresse- ô combien!- me questionne mais quand vous avez la responsabilité de donner une représentation de tout ça…
C’est une pièce aux destins sombres…
La pièce a des ambitions historiques puisqu’elle embrasse 50 ans du terrible vingtième siècle et mord sur le vingt et unième, un des siècles les plus tragiques de l’Histoire du monde et qu’elle affronte quelques unes de ses grandes tragédies : la tragédie du fascisme – et du nazisme de loin – , la tentation du fascisme américain et la grande espérance perdue du communisme soviétique. A l’intérieur de ça, elle introduit des personnages qui sont des jouets: ils sont manipulés, leur destin ne leur appartient pas vraiment. C’est une approche plutôt marxiste. La question qui sous-tend l’ensemble est la suivante: comment sachant ce que nous savons, comment sachant l’échec et la désillusion de toutes les grandes utopies du vingtième siècle, idéologiques, politiques et sociales, comment être encore dans une perspective de transformation ,d’espérance? ça, c’est une dimension très importante de la pièce et ce n’est pas un hasard si Bertolt Brecht en est un protagoniste. Brecht et sa parole et pensée qui ont été empruntées à ses propres textes….et comment représenter ça aussi d’ailleurs?
Il y a aussi une dimension politique très ambitieuse; c’est une grande fresque historique et en même temps, Christophe Pellet insère constamment l’approche la plus intime, la plus privée et le refus le plus caractérisé de la réalité puisque le monde est si décevant dans ses dimensions politiques, économiques , sexuelles, sociales, amoureuses (Ah l’amour! grand thème aussi!) .
C’est un théâtre réaliste?
C’est un théâtre réaliste par ce qu »il considère mais qui prend, au fur et à mesure de la pièce, le parti de la fuite du réel. La seule façon de vivre le réel, c’est de lui échapper. Comment traiter tout ça, sans que le public consente à une espèce de rhapsodie assez uniforme, assez plaisante, mais qui, sur 3 heures, serait un peu longuette? Commet échapper à la tentation du nostalgique , qui dans l’écriture est très forte, …et du joli? Je ne dis pas que ça explique les réticences et les silences des autres directeurs mais je pense que – ceux qui l’ont lu!- ont du avoir peur de ce matériau très difficile et dont je ne mesurais pas dans cette semaine assez euphorique à Limoux ce que cela nécessitait de travail conséquent sur l’écriture, la forme, le jeu,l’écriture scénique: non, je ne mesurerais où ça allait m’entraîner.
Comment avez-vous traité les nombreuses didascalies très précises du texte?
Je dirais même que dans le plaisir de la lecture, les didascalies et le descriptif font partie intégralement du texte. Ces didascalies, descriptions assez séduisantes d’ailleurs, s’insèrent entre le texte dialogué, porteur d’une action et d’un conflit et les monologues où les personnages revisitent leur mémoire, leur passé et rêvent sur ce qu’ils sont en train de vivre à côté de ce qu’ils sont en train de vivre. Je dois prendre en compte la spécificité de chacune de ces écritures.
En plus, Christophe Pellet est un élève de la FEMIS, ce n’est pas un littéraire au sens strict, c’est un cinéphile et un cinéaste. Donc ses textes sont saturés de références; c’est ce qu’on a en commun d’ailleurs. Donc chaque séquence est une citation plus ou moins explicite d’un très grand souvenir de cinéma et peut-être le plus grand d’entre eux, c’est ce grand cinéaste viennois, exilé à Hollywood sous le fascisme, Douglas Sirk, le flamboyant cinéaste du mélodrame. Il y aussi des citations de westerns, de comédies musicales etc…chaque séquence a un référent.
Un mot sur les comédiens avec lesquels vous travaillez…
Je travaille avec la troupe la plus composite que je n’ai jamais eue. C’est un grand charme et une grande complication aussi. La distribution de Limoux était une très belle distribution et tous ceux qui ont pu rester sont dans le spectacle d’aujourd’hui. Ce sont des comédiens suggérés par Jean-Marie Besset. J’ai une distribution étonnante où les sept comédiens appartiennent à peu près à sept familles du théâtre – cela renvoie d’ailleurs à la grande hétérogénéité du théâtre français. Il faut gérer ça aussi: des styles de jeu, des pratiques théâtrales très différentes …or il faut réussir à instaurer un travail très collectif et homogène: un travail de troupe…. avec de grands solistes si possible.
Vous avez dirigé à la fois comme un réalisateur et comme un metteur en scène?
C’est vrai qu’il y a aussi une grosse partition d’images avec des projections filmiques et beaucoup de figures du cinéma sont empruntées: les changements de plan, le gros plan et le plan lointain, le montage cut, le passage du fondu enchainé, du flashback, de l’anamorphose, du morphing. Toutes ces figures, je les emprunte au vocabulaire du cinéma mais je n’oublie jamais que c’est un théâtre et j’affirme simultanément la présence du théâtre, sa présence concrète. Le décor représente une petite scène de cinéma qu’on appelle « setter » aux Etats-Unis et que j’ai empruntée au grand peintre américain Edward Hopper, grand chroniqueur de l’Amérique profonde des années 30 à 50… et si vous saviez combien l’amour du cinéma passe par l’amour de la peinture d’Hopper! Sur le plateau, on voit une petite salle de cinéma américain mais qui est aussi un ancien théâtre avec les dorures, les stucs etc… pour que les deux arts soient complètement confondus sur scène. Cet espace métaphorique, mythique fait appel à la fois aux techniques du théâtre et du cinéma.
Dans la pièce, Christophe Pellet fait dire à Beltolt Brecht qu’« au théâtre, le public régule la représentation » tandis qu’au cinéma » le public se trouve face au résultat d’une production qui s’est faite en son absence « ,est-ce donc plus facile de faire un mauvais film qu’une mauvaise pièce?
Brecht déteste le cinéma hollywoodien, il le considère comme le cinéma du divertissement, un cinéma qui refuse le réel , tourne le dos à l’Histoire, bref qui fait diversion. Au théâtre, selon lui, le spectateur est actif, c’est lui qui donne du sens à ce qui lui est représenté.Au cinéma, il est totalement passif et manipulé. Idem pour l’acteur. Au théâtre, il prend parti sur l’histoire, le personnage; au cinéma, il n’est qu’un visage, une image qu’on l’aide à reproduire de film en film. Dans un premier temps, cet hymne au cinéma est une condamnation du cinéma. Pourtant la pièce se termine dans un exaltation absolue de l’image cinématographique, du pouvoir d’enchantement et de déréalisation du réel.
Une des protagonistes, Agnès, dit lors d’une discussion avec Anne, la jeune femme qui travaille à la cinémathèque que » l’image tue l’imagination »….
Il y a là une image presque prospective c’est à dire que ça représente une femme qui a été abandonnée et qui a l’amertume d’une intellectuelle d’aujourd’hui, a perdu sa première petite fille et a un adolescent qu’elle renie très cruellement et qui est accro totalement aux jeux vidéos. C’est l’expression d’une condamnation et d’une peur panique de l’aliénation du numérique etc…et dans le temps même où cette mère condamne irrémédiablement cette représentation du monde, Anne dit le contraire. C’est pour cela qu’il est important de ne manquer le rendez-vous du conflit et de l’affrontement dans cette pièce et de ne jamais céder à la psalmodie qui menace un peu l’écriture.
Vous dîtes dans la postface que dans les pièces de Christophe Pellet, les femmes résistent mieux que les hommes…est-ce vraiment le cas dans Loin de Corpus Christi?
Loin de Corpus Christi est quand même une histoire de femmes et Anne et Norma sont victimes d’avoir rêvé le réel: Anne a aimé un homme mort cinquante ans avant qu’elle ne s’y intéresse et qu’elle n’a jamais rencontré, une rencontre d’écran donc; elle rencontre une image et elle en meurt. Elle perd son temps à courir derrière elle et à la fin ce sont ses derniers mots. Norma a essayé de concilier, à partir de ses origines plébéiennes et allemandes de jeune américaine, la passion militante d’une transformation du monde marxiste à l’américaine – qui idéalise quand même beaucoup – et en même temps une passion amoureuse avec un jeune homme dont elle souhaite faire l’acteur nouveau d’un monde nouveau. Echec total puisque les deux hommes qu’elle aura à ses côtés dans les deux parties de la pièce se révèlent , l’un vivre à ses crochets cyniquement, l’autre la subir pour l’utiliser mais tous les deux sont des indicateurs, l’un du FBI, l’autre de la Stasi. Elle a été flouée totalement. A la fin, sa réponse est un retour presque régressif à son enfance américaine. Un retour vers cette Amérique qu’elle avait fuie, elle qui avait choisi comme Eldorado l’Europe de l’Est communiste, qui refusait la chute du mur, la considérait comme une catastrophe historique, qui était si têtue et obstinée. C’est l’histoire de deux femmes qui, par des voies différentes, ont fui la réalité brechtienne et en meurent.
Il y a une autre femme, Kathleen, qui avoue à Anne rêver à partir d’un autoportrait attribué au Parmigianino…
Pour Kathleen, la réalité, c’est la beauté. Il n’y a pas d’autre réalité que la beauté. Aussi longtemps que la réalité n’accède pas à la beauté, elle n’a pas lieu d’être. Donc il faut que Richard Hart ressemble à cette toile. Ce thème, comme beaucoup d’autres que nous avons abordés, sont très présents dans l’écriture de Christophe Pellet.
Il y a aussi celui de la sexualité...
Oui il y a aussi le thème très complexe de l’homosexualité , de la bisexualité et du puritanisme. Il y a quelque chose comme de la détestation puritaine de la chair , c’est le cas pour Lance Fredricksen et Richard Hart et en même temps la souillure, le charnel, le sentiment du péché. On sent l’idée que sorti du réel, je suis puritain, je hais ce qui, en moi, a cédé à la sensualité, à la sexualité mais j’y consens quand même.C’est une aspiration à l’angélisme dans un monde mauvais, vénal, souillé.
Cette pièce est divisée en deux parties: les distingue-t-on dans votre mise en scène?
Oui même s’il y a une unité profonde entre les deux. La première partie, c’est la France en 2005, cette France vue à travers sa collaboration avec la cinémathèque française, une France réfléchie par le cinéma américain et puis Hollywood. La seconde partie se passe entièrement à Berlin Est. J’ai reconstruit les séquences de telle sorte qu’Hollywood fasse retour à Berlin Est mais qu’on soit toujours dans l’appartement de Norma Westmore.
A la fin, cerise sur le gâteau, on découvre une avalanche de trois longs monologues entremêlés qui sont situés, même s’ils n’en ont pas l’air. Norma parle depuis Los Angeles qu’elle a rejoint finalement et d’ailleurs , à la toute fin, elle a plus de 90 ans…puis elle est morte, spectrale. Anne a pris sa retraite dans un petit port de la côte normande et Clara, employée des archives de la Stasi, dont le poste consiste à essayer de permettre à l’Allemagne d’affronter son passé, se met à rêver sur Moritz Sostmann, l’ex-amant de Norma et que Clara n’a jamais connu. A partir d’un photomaton, Clara a fait un transfert amoureux un peu comme Anne avec Richard Hart. Dans l’épilogue, Norma est morte, Anne va mourir et Clara est embarquée dans une quête impossible….
Comment avez-vous imaginé cette distribution féminine et masculine?
Norma et Anne sont jouées par deux actrices tout à fait différentes ( Marianne Basler et Sophie Tellier). Une autre actrice, Tania Torrens, joue le rôle totalement symétrique de Norma qu’est Kathleen, cette femme qui a gardé ses convictions de progressiste et a été aussi la maîtresse de Richard mais qui a épousé un homme très riche et finit sa vie en grande bourgeoise parisienne. C’est aussi Marianne Basler qui joue la Norma cassée, de 65 ans puis de 90 ans, cette Norma qui, déjà âgée, s’offre quand même un jeune homme, sans que ce soit une histoire de cougar…et puis enfin une seule actrice, Annick Le Goff, pour Julie, l’amie lesbienne et excentrique de Norma à Hollywood, Agnès la mère pleine d’amertume et de désespoir face à son fils et Clara. Et chez les hommes, de la même façon, un seul acteur pour Richard et son double Moritz ( Brice Hillairet). Un seul pour Brecht et Pierre Ramut ( Bernard Bloch).
Richard Hart et Bertolt Brecht sont deux personnages réels introduits dans cette histoire imaginée par Christophe Pellet…
Oui, on a les dvds des trois films dans lesquels a tourné Richard Hart et quand on voit le vrai Richard Hart, typique de cet Hollywood de 47 où les jeunes premiers sont baraqués et puis le Richard de Christophe Pellet qui est son double rêveur, évanescent, ailleurs…Vous verrez à l’écran que Richard Hart n’est peut-être pasRobert Mitchum mais on n’est plus près du jeune Gary Cooper que de Clift Montgomery.
Et Bernard Bloch joue à la fois Bertold Brecht et Pierre Ramut…
Pierre Ramut a aussi une histoire assez belle : c’est un vieil homosexuel amoureux passionné d’Anne car les amours entre un homosexuel et une femme n’en sont pas moins fortes et intenses qu’un amour entre un hétérosexuel et une femme. C’est d’ailleurs une contrée qui ne m’est pas trop familière, ce monde de l’homosexualité. J’essaie de retraiter un matériau qui ne m’est pas spontanément naturel mais c’est ce qui est passionnant au théâtre….
Au travers des références au cinéma américain, Christophe Pellet est présent au coeur même du texte, non?
La question du cinéma américain n’est pas sans effet sur l’écriture car par moments, les personnages ont leur autonomie et sont très distincts et par moments c’est Christophe qui s’exprime à travers eux, totalement. Anne, par moments, c’est le cinéphile Christophe Pellet. Pierre Ramut ( Pierre Murat dans la réalité) qui est un grand ami de l’auteur exprime parfois de façon évidente – mais aussi problématique pour le metteur en scène – la pensée de Christophe Pellet. Comment préserver l’identité et la consistance objective d’un personnage quand par moments il se dissout dans la parole, le sentiment, la colère ou l’approche amoureuse de l’auteur?
Je dis ça parce que pour le vieux metteur en scène que je suis – ça doit être mon 140 ème spectacle – c’est un défi et c’est très passionnant. Ce serait presque plus normal que ce soit un jeune metteur en scène qui monte un jeune auteur mais je pense que cette jonction qui est au travail dans l’oeuvre, c’est à dire cette nostalgie du passé, l’amour passionnel et organique du cinéma américain qu’on a en commun, la conciliation d’un passé encore brûlant et d’une modernité qu’il s’agit quand même de maîtriser et de contrôler, il est peut-être bon de la confier à un metteur en scène qui a de l’expérience. En effet, à la fin des fins, il y a le spectateur. Il faut tout faire pour que le spectateur ait un accès, qu’il ne perde jamais le contrôle de ce qui lui est montré et raconté. Et très souvent au cinéma et même chez les cinéastes qui nous sont essentiels – et alors au théâtre n’en parlons pas! – il y a des choses ambitieuses qui sont proposées mais avec de telles complications que le spectateur a besoin qu’on lui crée un espace commun entre la scène et la salle, entre le monde et la fiction et c’est au metteur en scène de les réinscrire s’ils ont l’air de s’être un peu dissous dans le texte etc….Oui, dans le respect profond de ce qui est recherché, je mets en oeuvre aussi une économie et une vigilance à la clarté de la fable, à la complexité dialectique et contradictoire de ce qui est raconté.
Vous dîtes – toujours dans la postface- que « Christophe Pellet fait théâtre du déni du théâtre, de son superbe autant que feint déni du théâtre d’avant lui », que c’est un auteur » qui écrit où le mène son désir ». Entraîne-t-il la même aspiration à la liberté pour son metteur en scène? Ce spectacle, est-ce le résultat de deux libertés embrassées?
Quand Christophe Pellet me dit » Jacques, vous faîtes ce que vous voulez », c’est plus qu’un acte de confiance je crois, c’est déjà inscrit dans le texte : la pièce éditée est une hypothèse, une version dans laquelle chaque metteur en oeuvre choisit ses options – et je cite en exemple l’admirable Woyzeck de Georg Büchner mort prématurément et ses quatre liasses dont il faut prendre parti ,et sur leur ordre d’organisation et sur leur chronologie. Celui qui voudrait reproduire le texte tel qu’il est édité, dans une espèce de religion fétichiste du texte – et ça existe- ,-et pourtant Dieu sait si le texte m’importe!- , je lui souhaite beaucoup de courage! Christophe Pellet dit « faîtes ce que vous voulez » , pas seulement par confiance et générosité mais car il sait que ce texte est un «work in progress», quelque chose en devenir. C’est un beau défi mais un défi exténuant !
Vous êtes un homme de théâtre et de cinéma…est-ce la pièce qu’il vous fallait?
J’ai toujours dit que je faisais semblant de faire du théâtre: je fais du théâtre de ce que le théâtre refuse, de ce que le théâtre ne veut pas et un de mes maîtres essentiels est quand même Robert Bresson. Je fais théâtre de ce dont le cinéma ne veut pas et je fais théâtre de ma passion du cinéma..et là, ça tombe bien. Je fais théâtre aussi de cet insatiable désir de vivre ce qui arrive, de découvrir ce qui est en train de naître et en même temps d’être fidèle à une très longue histoire, c’est à dire de ne pas être à gueugueu à gaga devant une post-modernité dont je ne sais pas que faire si je ne parviens pas à l’enraciner dans ma propre histoire intellectuelle, existentielle et artistique.
Chaque oeuvre est un défi?
Oui, que ce soit mettre en scène Christope Pellet ou Jon Fosse ou encore Molière .
Vous avez mis en scène L’école des Femmes l’an passé..
Molière n’accède au comique que dans la traversée de la vision du monde la plus tragique. Il n’y a pas d’auteur plus tragique que Molière et pourtant il faut rire….mais à quel prix et comment? L’école des femmes est une épouvantable histoire, c’est un fait divers: un homme s’achète une petite fille de 4 ans dont il a le désir – Molière le dit, c’est écrit- il l’enferme et la séquestre, la maintient en enfance, intellectuelle et physique, achète une maison et pendant 13 ans, personne ne sait que cette petite fille est enfermée, laissée aux soins de deux abrutis, vieux paysans illettrés, et la pièce commence le jour où cet homme va enfin pouvoir épouser cette petite fille. C’est un fait divers digne de l’histoire de Vienne…et pourtant au cinquième acte, c’est une belle histoire d’amour entre un homme de quarante ans, puritain et qui a une peur panique de son désir et une jeune fille de 17 ans qui, en cinq actes, va devenir une femme qui aura tout compris de la vie. C’est une pièce immense. Alors évidemment, nous sommes à une époque un peu barbare, un peu inculte où l’on dit » Ah oui, mais si on ne rit pas à Molière »…pourtant il est important de savoir sur quoi on rit chez Molière!
Vous ressentez une évolution du statut de metteur en scène?
Je suis né dans un moment où la mise en scène – et ça allait trop loin quelquefois – avait tous les pouvoirs, à l’époque de Brecht et le Berliner, Stein et la Schaubühne, Strehler et le Piccolo, Kantor et, en France, je suis né de Vilar, du jeune Planchon. Il y avait des abus puisque le metteur en scène avait le pouvoir financier, politique,esthétique, existentiel, il régnait, c’était trop. A l’époque, le metteur en scène, l’auteur et les acteurs constituaient une entité dont le metteur en scène avait la responsabilité utile. Aujourd’hui la tentation est de construire un spectacle d’abord sur une tête d’affiche et de demander au metteur en scène une vague prestation ou alors il y a encore deux trois petits maîtres ineffables…Je pense en ce qui me concerne que lorsqu’ on travaille avec des têtes d’affiche, il faut – et cela se fait souvent avec leur accord – ne pas céder à ça et les mettre au service d’un projet plus grand qu’eux, au service d’une oeuvre. Ceux qui consentent à ce contrat d’abolition d’eux-mêmes sont des grands acteurs car le grand acteur, c’est celui qui accepte de disparaître. J’ai mis trente ans à comprendre que j’avais besoin de très grands acteurs pour disparaître ,pour accepter de se mettre en crise aux limites de la perdition.
Jacques Lassalle et la pédagogie?
J’ai toujours pensé qu’enseigner, c’était déjà mettre en scène et mettre en scène , c’était encore enseigner. J’ai enseigné à l’université d’abord puis j’ai eu une classe au conservatoire puis j’ai dirigé le TNS qui était à l’époque l’autre grande école du théâtre français public. Aujourd’hui encore, je quitte tout pour aller faire une masterclass n’importe où dans le monde; j’ai besoin de ça. La question de la pédagogie est une grande question…et en France, des grandes machines comme l’Ecole Florent avec 1500 élèves m’interrogent….Aujourd’hui c’est la demande qui commande l’offre alors que je suis d’une époque où le théâtre faisait une offre et où il fallait amener la demande du public à l’acceptation de cette offre. C’était le sens même du théâtre public. Aujourd’hui il faut sentir la demande et aller dans le sens de la demande.Les acteurs, leur premier employeur, c’est la télé, un certain cinéma et ils apprennent à devenir ce dont on a besoin. Pour les amener à l’élargissement, au dépassement et à la précision de la scène , c’est un travail titanesque. Une vie d’acteur est une vie tragique en même temps puisque l’acteur est celui qui gère sa séparation d’avec le monde, celui qui gère sa dualité mais c’est une formidable aventure de construction de soi dans le monde et ce n’est surtout pas la vénalité de quelqu’un qui se vend au plus offrant pour le confort et l’insignifiance de rôles sans intérêt. Quant aux autres, ceux qui sont embarqués dans des problématiques à la «Antonin Artaud», ceux-là ils dérouillent encore plus ou alors ils s’enferment dans une espèce de génialité confidentielle, une « génialité de chef lieu de canton ».
Et s’il fallait conclure?
Je publie toutes les décennies aux éditions POL des mémoires sur mon expérience de metteur en scène. Le dernier livre se nomme Ici moins qu’ailleurs, le précédent L’amour d’Alceste. L’Amour d’Alceste, c’est l’amour du metteur en scène: un amour inacceptable,inadmissible et possessif.
Il faut aimer énormément les acteurs.Il faut les aimer plus qu’ils ne s’aiment, les amener là où ils ne savent pas vouloir aller, là où ils ne veulent pas aller. Il faut accepter de ne pas être aimé pour cause de trop d’amour, c’est la grande problématique du metteur en scène. A chaque séance de travail, chaque répétition,de nombreuses questions se posent , à des niveaux d’urgence divers : la société d’aujourd’hui, l’idéologie de l’acteur, l’état des lieux, la technique de tel ou tel acteur, les manques qu’il faut essayer de combler, la complaisance et aussi la virtuosité qui est un ennemi comme le non savoir. L’acteur virtuose, c’est le pire: « Qu’est-ce que vous voulez? je vais vous le faire! « .
Une des plus grandes colères que j’ai eues , c’était au début où je travaillais au Français, contre un acteur avec lequel j’ai eu ensuite une relation très privilégiée et qui m’avait dit » Ecoutez Jacques, je sens que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez, je vais prendre un thé en face et quand vous saurez ce que vous voulez, vous m’envoyez l’assistant et je reviendrai… ». Je lui ai répondu » C’est une honte ce que vous me dîtes…je travaille pour vous, je roule pour vous, j’essaie de proposer quelque chose qui vous arrachera à ce que tout le monde attend de vous et qu’on a vu cinquante fois. » Je vous raconte une histoire qui dure depuis cinquante ans et qui fait que tous les matins je me dis » mais qu’est-ce que tu fais au théâtre, bon sang! « . Il n’est pas possible de détester le théâtre autant que je le déteste et il n’est pas possible de lui appartenir autant.C’est banal ce que je dis, c’est un paradoxe, c’est banal mais c’est violent.
Dates des représentations:
– Du 21 septembre au 6 octobre 2012 au Théâtre des Abbesses ( Paris)
– Du 10 au 19 octobre 2012 au Théâtre des 13 Vents ( Montpellier)
– Le 13 décembre 2012 au Préau, Centre Dramatique Régional de Basse-Normandie ( Vire)
– Du 26 au 30 mars 2013 au Théâtre des Célestins ( Lyon)
A découvrir aussi:
Catherine Riboli et Shakespeare comme il vous plaira
Comédie Française : Nicolas Lormeau fait entendre la musique étonnante des vers hugoliens
Moni Grego : rencontre avec une Sètoise de talent
