Propos recueillis par Nicolas Vidal – bscnews.fr / Eugène Green est une curiosité culturelle pour certains. Pour d’autres, il est un artiste, drôle d’appellation fréquemment utilisée par ceux qui ont du mal à nommer la légitimité littéraire. Eugène Green est l’un de ces écrivains talentueux, discrets et brillants qui nous enchantent par chacun de leurs livres. Il n’y pas une surenchère de production chez Eugène Green car chaque livre a un sens, une signification et une portée. Il ne publie pas un livre parce qu’il est temps. Il écrit un livre avec préméditation et sagesse, sur un sujet précis et assumé. Il nous avait enchanté avec la Reconstruction en 2009 (Editions Actes Sud). Aujourd’hui, il nous revient avec la Bataille de Roncevaux (Editions Gallimard), un roman formidable et brillant sur l’identité et les particularismes culturels, une histoire qui nous transporte sur les terres basques et nous offre une intimité langoureuse entre la langue et la spiritualité. C’est à n’en pas douter un des livres phares de cette année 2010 qu’il me paraît incontournable d’avoir lu ou de lire dans les prochains jours.
Parlons du cadre particulier dans lequel se déroule la Bataille de Roncevaux, pourquoi avoir choisi le pays basque comme décor de votre roman?
Le Pays basque est plus qu’un décor, c’est au cœur du sujet. C’est un pays que j’ai découvert au cours d’un tournage (celui du Monde vivant), et avec lequel j’ai ressenti immédiatement une affinité. Ensuite, plus j’explorais le pays et découvrais sa culture, plus je trouvais de résonances avec mes préoccupations les plus personnelles. Dans le roman, Euskadi est à la fois un cas précis, et en même temps une métaphore de la situation actuelle de l’Europe. Celle-ci est une seule civilisation, mais constituée de toutes les cultures particulières qui la composent. Elle se délite parce que ces cultures particulières sont en train de disparaître, la laissant comme un vieux corps sans âme.
Gotzon Peyrat, notre jeune héros est-il pour vous un héros ou un anti-héros à sa façon d’incarner le déclin d’une identité ?
Gotzon est héroïque dans la mesure où il a un idéal, et qu’il s’abstrait du monde autour de lui, dominé par une idéologie aliénante. Il réussit même à résister, en reconstituant, à sa façon, la bataille héroïque où les Basques ont vaincu l’occupant franc. Mais du point de vue de la mentalité atticiste de la République française, Gotzen vit en dehors de « la réalité », et c’est donc un marginal, un fou. Dans ce sens, vous pouvez le qualifier d’anti-héros.
La Bataille de Roncevaux formule une diatribe véhémente contre l’école républicaine. Quels sont vos reproches à son égard ?
Le régime mis en place à la fin de la seconde dictature bonapartiste a instauré l’école républicaine comme religio – ce qui lie les gens entre eux – d’un État sans religion officielle. Elle avait deux aspects, l’un positif, l’autre négatif.
L’aspect positif, c’est que cette école se donnait comme tâche de transmettre à tous les enfants, quelle que fût leur origine sociale, une culture commune de haut niveau, afin de créer des « citoyens » responsables et égaux, et pour tisser entre eux des liens.
L’aspect négatif, c’est qu’en suivant la ligne de l’abbé Grégoire, elle avait établi comme base de cette culture la langue française, et considérait toute autre langue, qualifiée du terme péjoratif de « patois », comme une maladie contagieuse qu’il fallait combattre pour le bien général. Or, en 1871, et encore jusqu’à la Première Guerre mondiale, la majorité des citoyens de la République avait comme langue maternelle un idiome autre que le français : l’occitan, le catalan, le basque, le corse, le breton, l’alsacien, et le flamand, étaient des langues inscrites depuis des siècles, voire, dans le cas de l’euskara, depuis des millénaires, sur une partie précise du territoire de l’État français, où ils constituaient la vision du monde, et le moyen d’échange normal, des habitants. Mais à l’école républicaine les enfants qui employaient ces langues maternelles étaient systématiquement humiliés et punis.
Contrairement à ce qui s’est passé en Espagne, l’école républicaine, en dehors de quelques poches de résistance, a réussi son génocide linguistique. En revanche, elle a totalement renoncé de nos jours à son programme positif, et il est officiellement admis dans l’Éducation nationale qu’il ne faut rien « transmettre ». Ainsi, dans des zones importantes de la République, là précisément où les familles sont dans l’impossibilité de faire cette transmission à sa place, l’école est devenue une simple garderie, qui ensuite lâche dans le monde des jeunes ne possédant aucune langue, ne se rattachent à aucune culture, et préparés seulement pour le chômage ou la délinquance.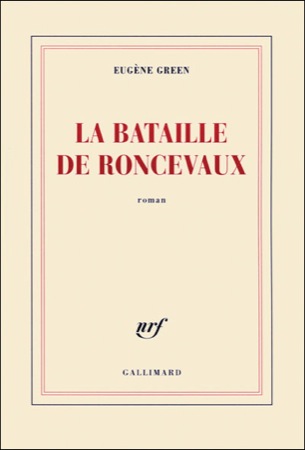
Dès les premières pages, un passage traite du fondement de l’être en tant qu’entité intellectuelle. Est-ce que cette entité intellectuelle est-elle un préalable à la survie des particularismes culturels tel que le pays basque dans votre ouvrage ?
Dans le passage auquel je crois que vous faites référence, Gotzon dit qu’il a toujours vécu au présent, ce que ne font pas beaucoup de gens. Cette conscience du présent veut dire qu’il vit aussi ce que le présent contient : à savoir, un passé, qui pour lui existe à travers sa langue et sa culture basques, et un avenir où il voudrait que cette langue soit toujours vivante. Dans ce sens, sa conscience intellectuelle de l’état des choses joue en effet dans son attachement à l’identité basque. Par ailleurs, c’est grâce à cette pleine conscience du présent qu’il peut ressentir des présences spirituelles liées à cette culture, et qui sont niées par le rationalisme matérialiste de son autre culture, française : par exemple les anges, le sanglier blanc, ou Andre Mari, la déesse basque de la nature.
Au début du l’ouvrage, Gotzon se situe à la conjonction parfaite du particularisme basque et d’une certaine idée de l’identité nationale (« Puisque je parle deux langues, chaque chose du monde existe deux fois et de façon différente « ). Ainsi, n’est-il pas un modèle d’assimilation dans les premiers pages du récit ?
Un immigré qui viendrait en France avec une connaissance parfaite de sa propre langue, et qui acquérirait une connaissance équivalente du français, pourrait être considéré comme un exemple réussi d’intégration, ou si vous préférez, d’assimilation. Mais, cela ne correspond pas à la situation des Basques.
Une forme de basque se parlait dans les Pyrénées et dans ce qui est aujourd’hui les terres gasconnes quand les Romains y sont arrivés, quatre siècles avant l’existence du royaume de France, et presque mille ans avant celle de la langue française. Au début du Moyen-Âge il y avait un État, le royaume de Navarre, qui réunissait tous les bascophones, et à cette époque, quand les textes parlaient de la « langue navarraise », cela voulait dire la langue basque. Cet état a été démembré en plusieurs étapes, entre le XIIIe et le XVIe siècle, au profit du royaume de Castille, mais la partie se trouvant au nord des Pyrénées est restée indépendante, et s’appelait encore le royaume de Navarre, mi-basque (le Labord, la Basse-Navarre, et la Soule) et mi-gascon (le Béarn). Jeanne d’Albret, reine de Navarre, a adopté le basque et le béarnais comme langues officielles de son royaume, qui, malgré l’avènement de son fils Henri comme roi de France, est demeuré, en principe, indépendant jusqu’à la Révolution (les Bourbons ont été sacrés « rois de France et de Navarre »). Tout ce résumé historique pour dire que les Basques du Nord n’ont jamais choisi d’être français. Ainsi, leur cas ne doit pas être comparé à celui des immigrés, mais à une situation coloniale.
Si cette situation coloniale avait été gérée intelligemment – mais on pourrait dire la même chose de l’Algérie – c’est-à-dire, en reconnaissant l’existence du peuple basque, en lui laissant l’euskara comme langue maternelle, employée dans l’enseignement et dans la vie quotidienne, mais en lui proposant en même temps un bilinguïsme français comme moyen d’échange avec une culture et une communauté plus larges, cela aurait donné une situation enrichissante et pour les Basques et pour la France. Mais on a préféré suivre les imprécations de l’abbé Grégoire et « exterminer les patois ».
Cela a donné, dans les cas comme celui de Gotzon, une situation schizophrène, puisqu’il se trouve avec deux langues, et donc deux êtres, mais qui se présentent – non pas par sa volonté, mais à cause de forces extérieures – comme des ennemis l’un de l’autre.
La langue basque n’est elle pas finalement la quintessence qui anime le héros et le propulse au coeur de ce roman initiatique de l’identité ? Oui, bien sûr. Gotzen est un jeune homme qui découvre la culture, l’amitié, et l’amour, comme tout le monde. Mais son initiation à la vie est plus complexe que celle de beaucoup d’autres jeunes, parce qu’il doit chercher l’unité à travers ses deux êtres, dont le plus important – celui qui existe à travers la langue basque – est nié par la société française dans laquelle il se trouve.
La Bataille de Roncevaux est tout sauf terre à terre. Quels rapports voyez-vous entre la spiritualité et la langue ?
Dans la tradition occidentale, la parole – le verbe – est le lieu de rencontre par excellence entre l’homme et le sacré. Concernant Gotzon et la langue basque, ce rapport est accentué par le fait que l’euskara est le lieu de son être secret, caché, comme l’est l’esprit dans la matière, et qu’au basque s’attache aussi tout une série de croyances spirituelles que le rationalisme refuse.
N’est ce pas cette langue qui fait basculer Gotzon dans le radicalisme ?
C’est le sentiment que le basque va disparaître, comme toutes les personnes auxquelles il s’attache (sa grand’mère, Ur, Maria), qui fait que Gotzon décide de passer à l’acte. Je suis absolument contre la violence physique à l’encontre de personnes, et donc de l’action de l’ETA, mais l’analyse que cet organisme fait de la situation n’est pas fausse : après des siècles d’efforts des deux côtés des Pyrénées pour faire disparaître la langue et l’identité basques, si on garde le statu quo, cette évolution négative est irréversible. Depuis deux générations la majorité des bascophones, convaincus que cette langue est un obstacle à la réussite sociale et à l’accession à la modernité, ont renoncé à la transmettre à leurs enfants. Par ailleurs, l’arrivée massive au Pays basque de Français et d’Espagnols ne parlant que la langue « nationale » ont rendu les Basques minoritaires sur leurs terres ancestrales. Même les enfants qui apprennent le basque à l’école renoncent à l’utiliser en dehors de ce contexte. Cela veut dire que, si les Basques n’obtiennent pas, au moins de facto, un État, où le basque serait la langue officielle, utilisée par tout le monde dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, cette langue – la plus ancienne d’Europe – est condamnée à disparaître au bout de quelques décennies. Cette idée est sous-jacente à la décision de Gotzon de « reconstituer la bataille de Roncevaux ».
L’attitude de notre jeune héros, Gotzon Peyrat ne lui confère t-elle pas une stature de porte-parole envers les personnages basques qui l’entourent dans le roman ?
Après la « bataille de Roncevaux », ses deux amis bergers lui racontent que dans le pays il suscite de l’admiration. Il dit lui-même que son geste est une réaction de colère, donc de résistance. Pourtant, quand il propose de participer au groupe d’Ur, son ami lui dit que ce genre d’action ne lui convient pas, parce qu’il « porte le Pays basque dans sa tête ». D’une certaine manière, ce que les représentants de l’État considère comme la « folie » du jeune homme est sa façon de faire passer dans le monde extérieur sa vision intérieure et mythique du verbe basque. Ainsi, c’est en poète que Gotzon devient le porte-parole de son entourage.
A votre avis, la spiritualité de Gotzon supplante ou sert-elle sa réflexion sur la conception de son identité ?
La spiritualité de Gotzon est inséparable de la façon dont il conçoit son identité. C’est en partant de son idée intuitive de ce qui constitue la spécificité basque, et en suivant ce que j’appelle « l’intelligence du cœur », qu’il se lance dans la quête initiatique qui lui permettra à la fin de grandir intérieurement, et de trouver une certaine paix.
Aujourd’hui, cette fiction est d’une actualité absolument criante au beau milieu d’une cacophonie sur l’identité, les particularismes et sur la diversité. Quelle(s) idée(s ) principales souhaiteriez-vous qu’il en ressortent ?
Dans le discours ambiant qui utilise les termes de votre question, on trouve mélangés des sujets et des problèmes très différents, qui exigent des réponses propres.
Depuis les années 1980, le point de référence pour les Français déculturés, c’est l’entité du Nouveau monde que j’appelle la Barbarie (USA), et dont la capitale politique est, je crois, Lessiville (Washington). Il n’y a pourtant aucun point commun entre la France et la Barbarie. Les colons qui ont créée celle-ci ont fait table rase, massacrant les habitants indigènes, et ils ont été ensuite rejoints par des colons du monde entier. Les noirs – principale population « diverse » – ne sont pas des « immigrés », mais les descendants d’esclaves qui ont été capturés, vendus, et traités moins bien que des bêtes. Les Barbares n’ont pas de langue, ni de mémoire collective, ni d’attache à leur terre, et l’unique chose qui les lie entre eux, ce sont les affaires qu’ils font les uns avec les autres.
La France est un pays de civilisation chrétienne, qui existe, en tant que telle, depuis presque deux mille ans, et qui est précédée de mille ans de civilisation gréco-latine. La France n’est pas « la République », vierge effarouchée créée par les « lumières » du XVIIIe siècle, cachée ou résistante pendant les diverses dictatures qui ont suivi, et qui brille de toute sa vertu dans les discours de gens bien-pensants. Être français veut dire assumer tout ce que comporte la mémoire collective de la France. C’est-à-dire, beaucoup de choses négatives : des guerres coloniales, depuis la croisade contre les Albigeois jusqu’à la guerre d’Algérie, la Révolution – premier régime totalitaire moderne ayant comme but de créer par la violence un « homme nouveau » sur la base de la Raison – les deux dictatures bonapartistes, et celle de Vichy. Mais c’est aussi une civilisation qui a donné au monde certaines de ses plus belles créations, une façon de vivre, une terre – ou une série de terres – et une langue qui constitue – comme toutes les langues – une vision unique du monde. Toute création « française » présente et future, tout pas en avant, ne peut se faire qu’à partir de ce qu’est réellement la France, dans sa totalité.
Tous les « nationalismes » nés au XIXe siècle sont des créations artificielles de l’intellect, des fruits de la Raison qui stérilisent l’intelligence du cœur, et ce sont eux qui ont provoqué la série de guerres qui, au siècle dernier, ont ébranlé la civilisation européenne. Mais pour que celle-ci puisse continuer à exister, il faut que toutes les identités puissent rester vivantes dans leur réalité.
Gotzon a acquis une vraie identité française, dans la mesure où il maîtrise parfaitement la langue, et qu’il a assimilé la culture, mais c’est une identité qui lui a été imposée, et en opposition à son identité basque, qu’il ressent comme un attribut « naturel ». Pourtant le Pays basque – des deux côtés – pourrait être un laboratoire de l’Europe. Car si on veut que ce continent continue à exister comme civilisation vivante et créatrice, chaque Européen devrait assimiler au moins deux langues et cultures autres que les siennes, ce qui est tout à fait possible, mais qui doit reposer sur un libre choix et sur des affinités. Si les Basques avaient la possibilité de vivre leur identité sans entraves – ce qui veut dire vivre tout aspect de leur vie dans leur langue – ils pourraient être en même temps français ou castillans, portugais ou allemands, mais dans la joie, et non dans la souffrance.
J’aurais beaucoup d’autres choses à dire à ce sujet, mais cela nous entraînerait trop loin par rapport au cadre de l’entretien. Pour conclure, je dirais simplement que j’espère – et ceci est essentiel pour l’avenir de l’Europe – que Gotzon fera des émules, et que la bataille de Roncevaux n’est pas encore terminée.
Eugène Green La Bataille de Roncevaux Editions Gallimard ( Crédit Photo Catherine Hélie et Karen Lavot)

