Vous êtes professeure de lettres et romancière. Y-a-t-il un lien entre les deux fonctions ? Évident ? Découvert?
Transmettre le goût de la littérature et surtout l’émotion qu’un texte peut déclencher suppose qu’on soit plongé dedans, qu’on vive d’elle, qu’on s’en nourrisse. Partager ce que l’on a de plus cher est un privilège. En revanche écrire est un exercice très solitaire ; on ne partage pas ce qui se passe lorsqu’on extrait de soi un texte. Y a-t-il un lien entre ces deux pôles de mon travail ? Oui et non. Mon écriture appartient au domaine que j’enseigne, mais ce qui me fait écrire n’a rien à voir avec mes connaissances lexicales, stylistiques, universitaires… Si pour Léonard de Vinci « la pittura è cosa mentale » (la peinture est une chose mentale, NDLR) pour moi écrire est une expérience sensuelle ; c’est mon corps qui cherche à se souvenir ou à se projeter.
Vous aimez les clins d’œil, les complicités auxquels vous n’hésitez pas à donner l’allure de farces, de vaudeville. Faut-il y voir une prégnance du théâtre pour lequel vous avez la même passion que pour l’écriture?
La gravité de certains sujets ne me fait pas peur, chacun de mes romans contient des épisodes douloureux. Mais la tonalité est joyeuse, « revigorante », selon certains lecteurs. Par goût pour les rebondissements au théâtre, peut-être, surtout à cause du plaisir que j’ai à rire et à lire des œuvres drôles. Un de mes auteurs préférés est Rabelais, mal aimé en France où il est très peu lu. J’ai beaucoup ri à la lecture des romans d’Albert Cohen, ou de Moi qui ai servi le roi d’Angleterre de Bohumil Hrabal, ou encore du Traducteur cleptomane de Kosztolanyi.
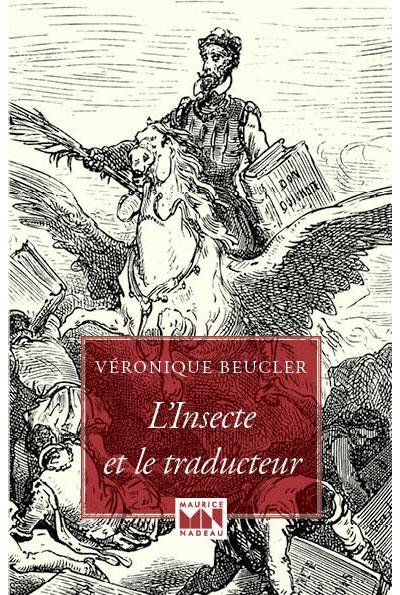
Quelle différence feriez-vous entre la mise en scène d’une pièce de théâtre et l’élaboration d’un roman?
Je n’ai pas appris à écrire en découvrant ce qu’est une litote, une anacoluthe ou une focalisation interne. Mais lorsque j’ai commencé à écrire des romans, je me suis aperçue que j’avais déjà écrit, sans le savoir, en mettant en scène une dizaine de pièces de théâtre. Vous avez un écheveau de fils épars, au moment de commencer une mise en scène ; il va falloir les tresser, les tisser. Texte et tissage ont la même origine, on l’entend dans le mot « textile ». Au début d’une aventure de théâtre -ou d’écriture – la discordance règne ; il faut intégrer des matériaux divers, tisser des voix, des actions, comme une toile damassée qui n’insère pas de motifs étrangers mais joue avec des fils, la lumière.

Pour autant, votre style est à la fois dépouillé et signifiant, et la ductilité des situations ne se fait jamais au détriment du fond. Est-ce douloureux ? Jubilatoire ? Les deux ?
Mon écriture est imagée. A tout ce que je décris, je cherche un équivalent tactile, visuel, auditif. Vous avez raison, ce n’est pas gratuit. « le monde tel qu’il est ne me semble pas satisfaisant » dit Caligula de Camus ; je partage son point de vue. Dans chacun de mes romans, une conscience s’indigne, mais comme vous l’avez souligné précédemment, cette voix n’est pas immédiatement perceptible ; on entend d’abord la joie de vivre, la saveur des mots, la cocasserie de certaines situations. Je ne vois rien de douloureux dans cette dichotomie, le plaisir d’écrire domine.
Dans un de vos livres, le lecteur assiste à une étrange mutation des personnages en hybrides porcins. Au-delà de la fable, n’y a-t-il pas une défense et illustration de la société contemporaine ? De certaines mises en lumière d’ombres phallocrates ?
Ô que oui j’acquiesce ! Vous avez bien remarqué que j’ai une dent contre la phallocratie et tous les abus de pouvoir, les appétits de puissance, les mâchoires, la prétention ou l’arrogance qui n’a pas le temps de s’attendrir devant l’éphémère, une bestiole, un pétale, tout ce que les enfants adorent.
Bénédicte, l’une de vos héroïnes est « l’absence faite femme »… Pourriez-vous préciser ? Faut-il y voir l’archétype féminin ?
Non ! Je ne suis pas archétypale, je ne donne pas de leçon de psychologie et de sociologie. Bénédicte est une adolescente au début du roman, complexée par une acné qui la défigure. Cette « absence » qu’elle rêve d’incarner est une façon de décrire son envie de disparaître, de ne plus avoir d’image.
Votre œuvre se caractérise par des histoires souvent inattendues qui se métamorphosent et engendrent des situations complexes. Le lecteur est confronté à des quiproquos qui peuvent le dérouter alors qu’il est entraîné dans la magie un peu déraisonnable de vos évolutions. Vous sentez-vous héritier de Marcel Aymé ou de certaines des métamorphoses de Kafka ?
Pourquoi ce jugement : « déraisonnable » ? Je revendique la liberté qu’offre la littérature, comme lectrice et comme écrivain. J’aime par-dessus tout les surprises ; le corollaire étant que je déteste les clichés, le déjà-vu, le prévisible, mais aussi le mal ficelé, ce qui ne tient pas debout. Je suis d’une logique implacable. Dans mes romans un élément de départ est irréel, le lecteur l’accepte sans peine. J’admets sans résister qu’Alice puisse traverser un miroir, que Mr Hyde soit la partie mauvaise du docteur Jekyll, comme le vicomte pourfendu existe, séparé en deux. Dans mes romans, un fœtus dans le ventre de sa mère dialogue avec elle, deux romanciers écrivent mot pour mot les mêmes romans sans se connaître, une épidémie de porcinite frappe un pays, un insecte secoue un traducteur et le pousse à écrire, mais une fois ces faits admis, tout se déroule dans la logique de notre monde. Je n’écris pas des récits fantastiques ou féeriques. Un élément magique ne suffit pas à changer de monde. Je ne connais pas très bien Marcel Aymé, j’ai cette chance, je le lirai un jour ! J’admire Kafka et Borges ou Italo Calvino… Je pourrais dévider une liste de « classiques » qui m’enchantent mais aussi des romans très récents comme Arden de Frédéric Verger, L’Autre rive de G. O. Châteaureynaud, Des Anges mineurs de Volodine ou Là où les tigres sont chez eux, et L’Île du point Nemo de J-M. Blas de Roblès – juste pour dire que je ne lis pas que des morts
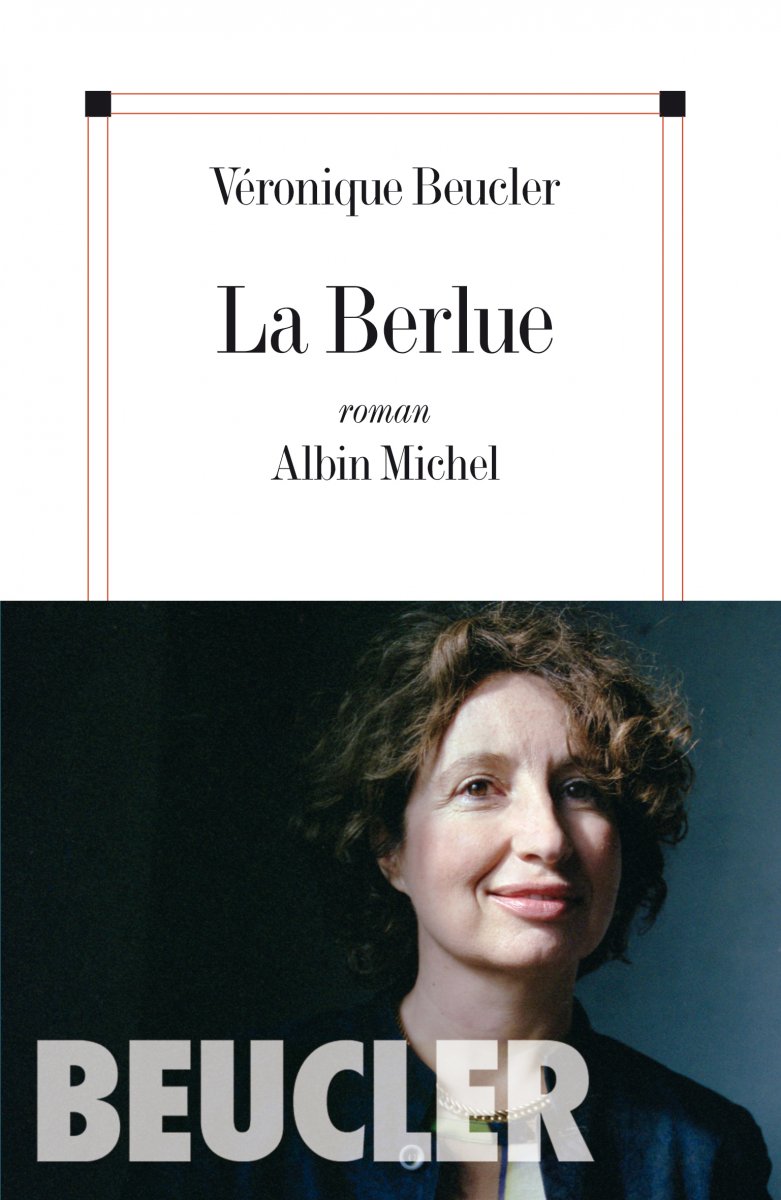
Vous avez beaucoup voyagé et séjourné dans des pays aussi différents que le Mexique, Madagascar ou l’Algérie où vous vivez actuellement. Est-ce que ces séjours nourrissent vos œuvres ?
J’ai vécu au Vanuatu, à Tananarive, Bogota, Mexico, Sarajevo, Casablanca, Madrid… pendant des années, je n’y suis pas passée en coup de vent. Je me suis nourrie de laplap, de brèdes mafanes, d’ajiaco, de tortillas de maïs bleu, de tamales, de lulo, inconnus en France, il doit bien en rester quelque chose en moi. Parfois, les lieux dans lesquels j’ai vécu migrent directement dans mes romans. Dans Les Particules de mon mari sont authentiques, certaines rues ou places colombiennes, mexicaines, équatoriennes se sont glissées dans une ville que je voulais imaginaire. Dans L’Insecte et le traducteur c’est Madrid qui s’est imposée. Je ne sais pas comment se font ces infiltrations. Quand elles sont justes, je les laisse faire, je les accueille.
Votre dernier livre, Barbe bleue, qui n’est pas encore édité, vous aurait-il été inspiré – en tout ou partie – par l’Algérie ?
Je suis bien incapable de vous le dire. L’Algérie s’y trouve nécessairement puisque je ne l’ai écrit qu’ici. Mais où ? Qu’est-ce qui dans votre corps, dans votre voix, appartient aux pays où vous vivez ?
Seriez-vous d’accord avec Albert Camus qui écrivait : » jamais peut-être un pays, sinon la Méditerranée, ne m’a porté à la fois si loin et si près de moi-même… » ?
Je n’ai connu la Méditerranée qu’à 18 ans. Mais elle était là bien avant, dans Le Comte de Monte Cristo que j’ai lu – je n’exagère pas – une quinzaine de fois. J’ai conscience de cette « pathologie » ! La Méditerranée d’Edmond Dantès, c’est Marseille, les « Catalans » de Mercédès, « les allées de Meilhan » où habite le vieux père d’Edmond, le château d’If, l’île de Monte-Cristo, la Corse, la Sardaigne… Ensuite, la Méditerranée a été celle de Camus. C’est dire qu’au commencement de tout, comme expérience fondatrice, je trouve la littérature. Je plagierai donc la phrase de Camus : « » Aucun pays, à part la littérature, ne m’a porté à la fois si loin et si près de moi-même… «
Véronique Beucler a déjà publié :
L’Amour en page, Le Passage, 2003
La Berlue, Albin Michel, 2006 (1)
Préface de Quel ennui ! Essai philosophique et littéraire, Alain Jay, L’Harmattan, 2007
Les particules de mon mari sont authentiques, Albin Michel, 2008 (2)
La décadence et autres délices, Dialogues, 2011
L’insecte et le traducteur, Maurice Nadeau, 2015
© 2018 PUTSCH – Toute reproduction (également dans une langue autre que le français) est interdite sans l’autorisation de l’auteur
(crédit photo – Véronique Beucler)

